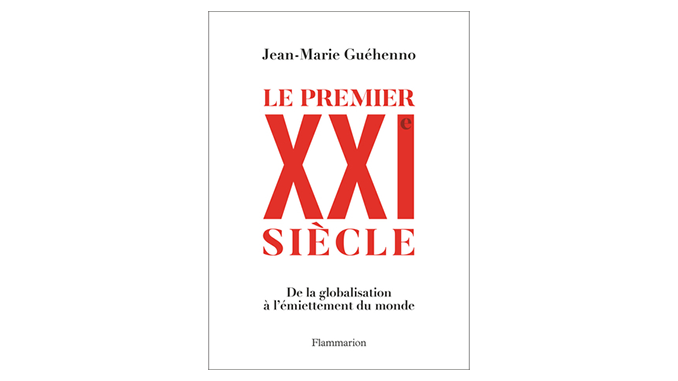
Diplomate français, spécialiste des questions de défense et des relations internationales, Jean-Marie Guéhenno a été Secrétaire général adjoint au Département des opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies (2000-2008). Il est aujourd’hui professeur à Columbia University à New York. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Le premier XXIe siècle » aux éditions Flammarion.
Vous estimez qu’au moment où l’Occident démocratique traverse la crise la plus grave de son histoire depuis la fin de la guerre froide, il y a dans l’obsession chinoise un risque de diversion…
La Chine a un projet de puissance qu’on aurait tort d’ignorer, et les Européens ont raison de se doter – tardivement – d’instruments efficaces pour protéger leurs infrastructures critiques et ne pas devenir excessivement dépendants de la Chine, mais le plus grand défi est ailleurs : certains aspects du « modèle chinois », quand on les compare à nos sociétés démocratiques en pleine décomposition, risquent de devenir de plus en plus attrayants ; autant la répression des Ouïghours fait à juste titre horreur, autant la dictature douce, et pour ainsi dire invisible, que le système chinois de crédits sociaux tente d’instaurer, crée une tranquillité, une « harmonie », qui peut faire envie à des sociétés qui se déchirent. La vraie menace est à l’intérieur de nos sociétés, dans leur fragmentation croissante, que nous ne savons comment surmonter. Les Occidentaux, au lieu de se construire un ennemi qui les rassure sur leur supériorité morale, doivent d’abord regarder en eux-mêmes, et réfléchir aux moyens de retrouver la capacité à porter des projets collectifs, tout en préservant le désordre démocratique, avec ses conflits mais aussi la créativité d’individus libres. Et cela sans sombrer dans le nationalisme… Ce ne sera pas facile.
Vous craignez que ce que vous appelez « le complexe militaro-informationnel » exerce une influence encore plus grande et plus dangereuse que le complexe militaro-industriel de la guerre froide…
Le pouvoir, la richesse sont aujourd’hui dans la maîtrise et le traitement des données. On s’inquiète des effets les plus visibles de cette nouvelle donne de la puissance : la capacité d’espionnage qui menace l’espace privé, la capacité de manipulation qui peut influencer les compétitions électorales. En réalité, les effets sont beaucoup plus profonds, car c’est la structure même des sociétés, dans ses dimensions politiques et économiques, qui est en train d’être redéfinie par les nouveaux maîtres des données. En Occident, l’Europe ayant raté la première révolution des données, les quelques grandes sociétés qui dominent cette nouvelle économie sont exclusivement américaines. Elles ne se confondent pas, et ne veulent pas se confondre, avec l’État américain, mais dans la pratique, ne serait-ce que pour faire face à leurs concurrents chinois, qui eux ont partie liée avec l’État chinois, elles seront de plus en plus obligées de travailler avec les autorités qui les règlementent. Et cette extraordinaire concentration de pouvoirs, aujourd’hui sans réels contre-pouvoirs, me paraît beaucoup plus dangereuse que le complexe militaro-industriel de la guerre froide, qui se contentait de défendre ses intérêts industriels avec les moyens classiques de la propagande : elle est à la fois plus insidieuse, et plus radicale, car elle remodèle l’ensemble des sociétés occidentales.
Pour vous, la peur du terrorisme hante nos sociétés d’une façon qui n’a pas de précédent dans l’histoire, bien que la probabilité d’être victime d’un acte de terrorisme reste très faible, en particulier dans les pays riches. Comment expliquer cela ?
Les statistiques mondiales du terrorisme n’ont pas de sens : elles additionnent les victimes de pays en guerre comme l’Afghanistan ou la Syrie, où les victimes se comptent par milliers, et les victimes de pays riches où, la plupart des années, le terrorisme reste un phénomène exceptionnel. Néanmoins, le discours public des sociétés riches se sert de ces statistiques pour faire du terrorisme une menace stratégique, alors qu’il est seulement le révélateur de la fragilité de sociétés qui, faute de projet collectif, rêvent d’une société à risque zéro. Il ne devient menace stratégique que parce que son impact psychologique est infiniment supérieur à ses conséquences matérielles directes. La seule émotion partagée est désormais la peur, une peur qui ne produit pas un sursaut collectif, mais plutôt un mouvement de repli. Elle engendre une relation infantilisante avec les institutions et l’Etat : on en attend une protection totale, qui est hors de portée, et cette déception structurelle alimente le cercle vicieux de la méfiance et de l’hyper-individualisme. À chaque époque a correspondu un type de conflit, qui correspond aux structures et à l’échelle de valeurs d’une société particulière. La violence individualisée du terrorisme est à l’image de notre société en miettes.
Vous proposez de substituer à l’opposition entre la démocratie et les dictatures un autre débat plus complexe sur le type de société qui offrira à chaque être humain la possibilité d’accomplir pleinement son destin humain, qu’entendez-vous par cela ?
La plus grande force de l’idée démocratique est d’affirmer la dignité de chaque individu ; et on a vu il y a dix ans combien cette revendication de dignité a été une dimension essentielle dans les printemps arabes. Mais les démocraties contemporaines oublient ce qui les légitime : l’attention presque exclusive qu’elles portent au succès électoral, arbitre de la politique comme le marché l’est de l’économie, transforme les citoyens en « particules élémentaires » qui ne comptent que par le vote qu’ils expriment. L’idéologie de la réussite, économique, sociale, électorale, écrase toute autre hiérarchie de valeurs, comme si la vie était un grand concours, où les premiers seront les chefs, et les derniers les éboueurs. Bien sûr, la méritocratie – et nous en sommes loin – vaut mieux que la ploutocratie, mais elle ne peut pas être la réponse unique. Il y a bien des manières de définir le mérite, et une société authentiquement pluraliste est une société qui accepte des légitimités concurrentes et reconnaît la diversité des chemins qu’un être humain emprunte pour s’accomplir. Une bonne partie de la violence contemporaine est une réaction contre le mépris dont ceux qui n’ont pas « réussi » selon les critères dominants se sentent l’objet. La demande, à mon sens problématique, de démocratie directe, est un autre symptôme de la frustration qu’engendre une société devenue unidimensionnelle.
Cet article est également disponible sur MediapartLeClub.
