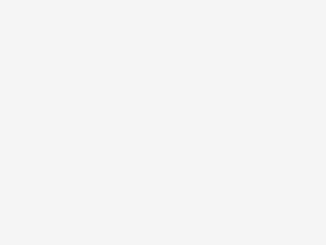Michel Wieviorka est directeur d’études à l’EHESS et président de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Face au mal. Le conflit sans la violence », aux éditions Textuel.
En réfléchissant aux motivations d’un terroriste, vous écrivez que deux dangers guettent l’analyste : le sociologisme est le psychologisme. Pouvez-vous expliquer ?
Le terrorisme trouve certaines de ses sources dans le travail de la société sur elle-même, et dans des processus de perte et de recherche de sens. C’est pourquoi l’analyse sociologique peut s’intéresser à la crise des banlieues, aux transformations de l’immigration depuis les années 70, à la quête de sens caractéristique de centaines de jeunes filles désireuses de rencontrer le grand amour ou de vivre une expérience initiatique au Moyen-Orient ; elle peut reconstituer des parcours depuis le quartier populaire, l’échec scolaire, la délinquance, la prison, etc. Il y a une réelle diversité.
Mais la sociologie classique ne dit pas pourquoi ce sont quelques individus qui passent à l’acte, parmi des dizaines ou des centaines de milliers d’autres qui leur ressemblent sociologiquement : elle risque alors de devenir un sociologisme, qui passe à côté des caractéristiques des acteurs du terrorisme, individuelles, hautement personnelles ou singulières.
D’autre part, si l’on se contente d’examiner la personnalité des terroristes, leur psychologie, avec d’ailleurs une tendance excessive à psychiatriser à l’excès leurs conduites, on court le risque symétrique, qui consiste à ignorer le lien de leurs actes avec leur histoire sociale, qui est elle-même comparable à celle de très nombreuses autres personnes – c’est le psychologisme.
D’où mon humble proposition : circuler en permanence entre les deux registres, l’analyse sociologique, et celle de la personnalité, sans donner le monopole à l’une ou l’autre perspective.
Pourquoi, à rebours de nombreuses personnes, estimez-vous que l’acceptation de la violence a diminué aujourd’hui ?
La violence relève d’approches quantitatives qui se veulent objectives – on compte les morts, les blessés, on examine le coût des dégâts matériels, on réalise des sondages pour apprécier les préjugés et les stéréotypes haineux, etc. Et même si les statistiques méritent toujours examen, sur le long terme, elle est historiquement à la baisse. Et elle est hautement subjective, ce qu’une personne, un groupe, une société considère comme tel.
Je constate qu’il n‘y a plus d’intellectuels, ou bien peu, pour faire l’apologie de violences sociales ou politiques, jugées émancipatrices, par exemple liées à la décolonisation, comme au temps où Jean-Paul Sartre rédigeait une préface incendiaire au livre de Franz Fanon, Les damnés de la terre, appelant à la compréhension. Je constate aussi que des violences qui n’étaient pas acceptées ou reconnues comme telles sont maintenant au cœur du débat public : il a fallu les dizaines d’années de luttes féministes, mais aussi le récent palier franchi avec l’affaire Weinstein, pour que les violences faites aux femmes deviennent un crime aux yeux de l’opinion, et pas seulement des faits dont on ne parlait guère ; ou pour que la pédophilie de certains enseignants ou de certains prêtres cesse d’être couverte par les institutions, tue, et donc ignorée par la société.
Je note aussi que la violence, dont l’État est supposé avoir le monopole légitime, selon la célèbre formule de Max Weber, est perçue, quand elle n’est pas le fait de cet État, comme un problème non seulement du point de vue de l’ordre qu’elle met en cause, de l’État qu’elle dépossède de son monopole, des institutions qu’elle interpelle, mais aussi comme une atteinte à l’intégrité physique et morale de ses victimes – ces dernières n’existaient guère dans le débat public il y a cinquante ans ; aujourd’hui, elles sont entendues et écoutées, ce qui d’ailleurs soulève d’autres questions (la vérité de leur parole).
Pourquoi plaidez-vous pour la reconnaissance de la centralité des relations conflictuelles dans une société ?
Toute mon expérience de chercheur ayant étudié durant une quarantaine d’années le terrorisme, les violences urbaines, le racisme, l’antisémitisme, plaide pour que ce qui divise une société soit traité comme tel, et non nié ou refoulé au profit de l’idée qu’il faut promouvoir uniquement l’unité du corps social, de la nation ou de toute autre forme de vie collective.
Pourquoi le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes a-t-il été abandonné ? Parce qu’une mobilisation a conflictualisé la question. Pourquoi, plus largement, une société se transforme-t-elle ? Parce que des contestations, des demandes sociales, culturelles, économiques ou autres se sont exprimées, ou non, sous une forme ou sous une autre. Quand le débat peut s’organiser, quand le conflit peut être traité institutionnellement, sans violence, alors la société est vivante et se porte mieux que lorsqu’il y a crise, blocage, incapacité de débattre. Je note qu’aujourd’hui, la situation politique est de ce point de vue préoccupante, car il n’y a guère de débat réel ou d’opposition crédible, ni à gauche ni à droite, en dehors d‘extrêmes eux-mêmes sans perspectives ni réels débouchés électoraux.
Une société est à la fois unité et diversité. S’il n’y a que des discours et propositions d’unité, tout ce qui relève de la division et de la diversité risque d’être réduit au silence, à l’impuissance, et de là, parfois, à des logiques de rupture, à la violence et à la haine raciste, xénophobe, antisémite, etc. C’est pourquoi les tentations nationalistes sont si inquiétantes. C’est pourquoi aussi il est contre-productif d’en appeler à la République une et indivisible et à ses valeurs de façon incantatoire en direction de ceux qui ont le sentiment de ne pas bénéficier de l’égalité, la liberté ou la fraternité qu’elle promet : ce discours ne leur laisse pas la possibilité de faire entendre réellement leurs espoirs, leurs difficultés, leurs reproches autrement que sur un mode radical, voire sectaire ou violent.
Cet article est également disponible sur Mediapart Le Club.