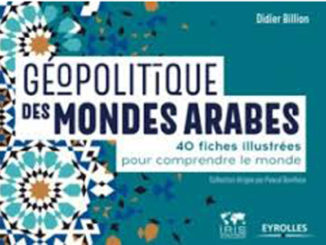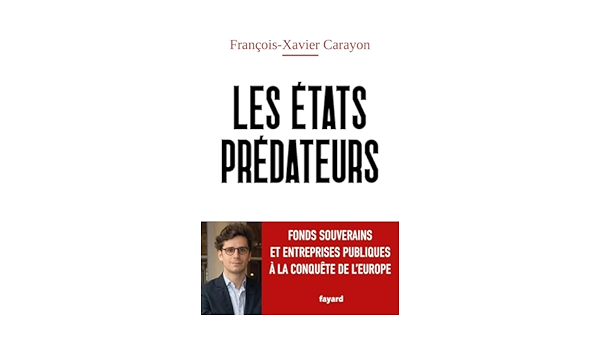
François-Xavier Carayon est consultant en stratégie. Il poursuit en parallèle une activité de recherche consacrée aux questions d’économie politique internationale et de finance éthique, disciplines qu’il a enseignées à HEC et IRIS Sup. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Les États prédateurs », aux éditions Fayard.
Les États investisseurs seraient-ils aussi des États prédateurs ?
Mon enquête fait la lumière sur la manière dont certains États se transforment en prédateurs sur les marchés internationaux, et particulièrement sur le marché européen. Quand un État investit à l’étranger, il ne représente pas la même menace qu’un fonds ou une multinationale privée.
Pour comprendre le phénomène, il faut remonter un peu en arrière. Dans les années 1980 et 1990, le rôle de l’État dans l’économie semble voué à reculer. Les vagues de privatisations déferlent, non seulement dans le monde « développé », mais aussi dans celui « en développement », y compris en Chine.
Mais la plupart des grandes puissances du « Sud global » en sont revenues. À partir des années 2000, elles ont décidé de redonner un rôle majeur à l’État actionnaire. Hier gestionnaire des services essentiels de l’économie domestique, l’État actionnaire devient chez elles investisseur, avec un goût prononcé pour les marchés étrangers.
Par leurs investissements transnationaux, les États peuvent bien sûr aller chercher du rendement financier traditionnel, sans volonté d’influence sur les actifs sous-jacents. Mais ils tendent aussi, de façon croissante, à promouvoir leurs intérêts politiques par des acquisitions ciblées.
Par leurs investissements publics, les puissances étrangères peuvent chercher à accroitre leur autonomie stratégique (comme Singapour ou l’Arabie saoudite dans l’agroalimentaire), renforcer leurs alliances (comme le Qatar en France), mais aussi construire leur domination stratégique sur les nations rivales (comme la Chine dans les métaux critiques ou l’électronique). Quand ces États prennent un poids critique dans certains secteurs vitaux de notre économie ou qu’ils prennent le contrôle de nombreuses infrastructures critiques, ils se dotent d’un levier de menace géopolitique.
Les investisseurs publics étrangers peuvent aussi chercher à prendre le contrôle de nos meilleurs atouts industriels ou technologiques. Cela constitue alors une menace à notre prospérité collective, à notre emploi et notre croissance.
Selon vous, de peur de se couper de la manne des capitaux étrangers, nos dirigeants s’accrochent à tout prix à l’ouverture des marchés ?
Nos dirigeants sont conscients que notre croissance économique est largement tributaire des capitaux étrangers. Ils ont raison.
Pour autant, il faut être capable de distinguer les investissements qui nous profitent de ceux qui nous asservissent ou nous appauvrissent. Aujourd’hui, les dispositifs français et européens de filtrage des investissements étrangers sont insuffisants pour détecter et entraver les menaces. D’abord parce que les investisseurs publics étrangers sont de plus en plus subtils et discrets : ils ciblent des entreprises de petite taille, des sociétés non cotées, réalisent des investissements greenfield… et le tout parfois via des cascades de sociétés d’investissement rendant quasi invisibles les donneurs d’ordre réels. Ensuite parce que nos dispositifs manquent de moyens et pèchent encore trop souvent par naïveté. Qui plus est, ils ne sont pas autorisés à défendre nos intérêts purement économiques : ils se contentent de nous protéger — avec plus ou moins de succès — des investissements menaçant l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
Je révèle dans ce livre des dizaines d’acquisitions qui sont passées sous les radars. Les entreprises rachetées appartiennent à de nombreux secteurs clés de notre économie : biotechnologies, robotique industrielle, aéronautique, édition scientifique, etc. Je fais aussi le clair sur les infrastructures critiques passées sous pavillon étranger, comme les réseaux électriques et les réseaux gaziers d’une partie du sud de l’Europe, ou encore quatorze ports européens.
Quels sont les fonds souverains dont nous devons le plus nous méfier ?
Les fonds chinois sont à bien des égards les plus menaçants, et notamment le China Investment Corp (CIC) qui gère à lui seul plus de 1 300 milliards de dollars.
Mais il ne faut pas sous-estimer les velléités des investisseurs publics venus du reste du monde. Les outils d’investissement développés par Pékin essaiment un peu partout en Asie (Corée du Sud, Malaisie, Inde, Kazakhstan…) et au Moyen-Orient (Arabie saoudite, EAU, Koweït, Qatar…), y compris dans des pays considérés comme ultralibéraux, tels que Singapour. Leur puissance de feu se compte généralement en centaines de milliards de dollars.
Pour lever une partie des doutes légitimes qui pèsent sur ces investisseurs publics, une mesure simple consisterait à exiger la transparence de l’ensemble de leurs investissements durables à l’étranger. C’est déjà une règle que s’applique à lui-même le fonds norvégien, le Government Pension Fund-Global (GPFG), qui se trouve être le plus gros fonds souverain au monde. Cette mesure — que pourrait porter le Fond Monétaire International (FMI) ou le Conseil de Stabilité Financière (CSF) — aurait le mérite d’encourager des échanges financiers ouverts et pacifiés qui profitent réellement à chacun.
Vous écrivez que, chantres de l’ouverture, les présidents américains ont dans le même temps construit l’un des marchés nationaux les plus protégés du monde développé…
Oui, les Américains ont élaboré un dispositif de filtrage des investissements étrangers robuste : le Comité pour l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS). Il permet de protéger les menaces à la sécurité nationale au sens large, incluant la sécurité économique du pays.
D’autres pays libéraux se sont dotés d’outils de protection également vigoureux. C’est le cas de l’Australie ou encore du Canada, qui a développé le concept intéressant de « bénéfice net national » pour déterminer le bienfondé d’un investissement étranger sur son sol.
Quand certaines voix courageuses appellent à muscler nos protections (on les retrouve partout sur l’échiquier politique, d’un Arnaud Montebourg à gauche, à un Olivier Marleix à droite), on trouve toujours des partisans béats du libre-échange pour s’inquiéter du risque de rétorsions étrangères. Les renforcements récents des dispositifs anglo-saxons nous enseignent pourtant qu’ils n’ont pas d’effet négatif sur l’attractivité du territoire, à condition que ces derniers présentent des atouts en termes de qualité de la main d’œuvre, de fiscalité et de fluidité juridico-administrative.
D’une certaine façon, le défi qui nous est posé par les États prédateurs est une chance. Il nous offre l’opportunité de briser un certain nombre de tabous, à commencer par le droit de protéger nos intérêts en entravant le marché libre. C’est là un enjeu décisif dans la compétition internationale : pas seulement pour nous prémunir des menaces venues des puissances en développement, mais aussi pour assumer, enfin, des rapports de force plus francs et virils avec les États-Unis, éternel allié, éternel rival.
Cet article est également disponible sur le site de l’IRIS et Mediapart.