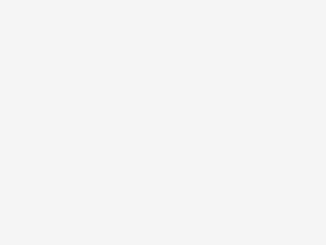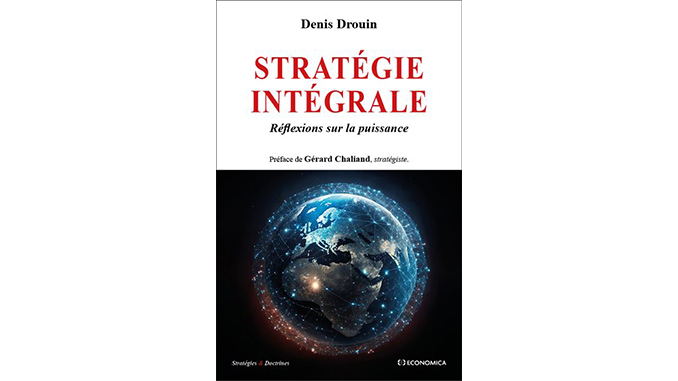
Après une longue carrière dans l’industrie de défense, observateur attentif des relations internationales, Denis Drouin est désormais chef d’entreprise. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage Stratégie intégrale, réflexions sur la puissance, préfacé par Gérard Chaliand, paru aux éditions Economica.
Comment définissez-vous la Stratégie intégrale ?
La « Stratégie intégrale » est un concept qui fut défini la première fois par le Général Lucien Poirier comme étant « la théorie et la pratique de la manœuvre de l’ensemble des forces de toute nature, actuelles et potentielles, résultant de l’activité nationale. Elle a pour but d’accomplir l’ensemble des fins définies par la politique générale ». La « Stratégie intégrale » appréhende le conflit entre deux collectivités humaines comme un phénomène social global. Sa résolution doit être envisagée par l’intermédiaire d’une combinaison de moyens issus non seulement du champ militaire mais aussi des champs économiques et industriels, diplomatiques et juridiques, culturels, médiatiques, etc. Cette manœuvre s’appuie sur une compréhension fine de la puissance, elle propose une combinatoire des facteurs de puissance plutôt que leur simple superposition, méthode bien moins efficace et pourtant beaucoup plus répandue. Elle rappelle que la violence armée ne peut à elle seule conduire à la résolution durable d’un conflit.
Des stratégies intégrales ont été menées tout au long de l’Histoire, depuis les Grecs et les Romains en passant par les Byzantins et les Chinois des Royaumes combattants. Plus récemment, on peut penser aux mouvements de libération anticoloniaux (Viet Minh, Mao, etc.), aux États-Unis (guerre de Sécession, guerre froide), au Royaume-Uni (guerres napoléoniennes, conquête des Indes), à l’URSS (guerre froide) et même à la France (Lutte contre l’Empire des Habsbourg, De Gaulle et sa politique africaine).
Les États sont-ils des acteurs stratégiques obsolètes ?
Si les acteurs politico-stratégiques sont aujourd’hui très nombreux et très divers, la puissance réside in fine dans le contrôle d’un territoire et de sa population. À ce titre l’État reste, et restera pour longtemps encore, l’institution incontournable de la scène internationale car il est censé s’arroger tous les pouvoirs régaliens. Cependant, l’État a toujours connu des concurrents directs (Églises, mafias, rebellions, etc.) qui cherchent eux aussi à s’emparer des attributs de la puissance et qui, en cas de succès, s’empressent de se substituer à l’État en reprenant à leur compte ses prérogatives. En somme l’État s’autoperpétue en tant qu’acteur politico-stratégique.
Depuis le siècle des Lumières, la nouveauté jaillit de l’émergence progressive d’une multitude de concurrents indirects (conglomérats industriels ou financiers, médias, organisations scientifiques ou philosophiques, ONG et Think Tanks, réseaux d’influence, etc.) qui s’avèrent parfois plus efficaces que la structure étatique pour contrôler la production et les échanges de richesses, notamment des biens immatériels tels que le savoir et l’information pour lesquels les frontières sont de plus en plus poreuses. Ces concurrents, qui ne remettent pas en cause radicalement l’État en tant qu’institution, sont néanmoins capables de mener des stratégies intégrales et de se faire une place au centre de la scène mondiale, en contestant aux États le monopole de la puissance.
Comment définir la puissance au XXIe siècle ?
La puissance a toujours été relative (à l’adversaire) et contextuelle (par rapport à une finalité donnée et à une situation vécue). Elle relie deux acteurs politico-stratégiques entre eux. Elle ne se trouve pas nécessairement dans les gros bataillons, la gesticulation médiatique, le chiffre d’affaires ou la part de marché, le nombre de followers sur les réseaux sociaux, la quantité de brevets déposés ou un classement au sommet d’une liste quelconque. Être puissant, c’est surtout savoir interagir avec l’adversaire afin de transformer une situation subie et insatisfaisante en une nouvelle situation imaginée et mieux conforme au projet politique ciblé. Créer cette interaction demande une compréhension à la fois étendue et profonde de tous les facteurs de puissance afin de concevoir, préparer et conduire une Stratégie intégrale. La puissance au XXIe siècle n’est pas différente de la puissance aux siècles précédents, elle se révèlera toujours par l’intermédiaire de notre liberté d’action et de notre maîtrise de l’initiative face à un adversaire.
Y-a-t-il des alternatives à la dissuasion nucléaire ?
L’atome militaire est une arme qui, en soi, peut être utilisée pour des buts aussi bien offensifs que défensifs, à l’échelon tactique comme au niveau stratégique. Cependant, compte-tenu de sa puissance de destruction unitaire, l’arme nucléaire s’associe très bien avec le concept de dissuasion qui est, au demeurant, un mode défensif vieux comme la stratégie elle-même. Ainsi, les stratégistes ont étudié des doctrines de dissuasion nucléaire élégantes, renforcées par une machinerie technico-opérationnelle parfaitement rôdée, dont le domaine de validité se trouve restreint à l’exercice d’une menace crédible sur les éléments vitaux d’une nation. Toutefois, ces modèles théoriques reposent in fine sur la qualité du dialogue entre dissuadeur et dissuadé, et en particulier sur la volonté politique de celui ou celle en charge d’appuyer le moment venu sur le bouton rouge. C’est le dissuadeur qui menace mais c’est l’adversaire qui décide d’être dissuadé.
Or les obstacles pratiques à la pertinence d’une décision politique sont nombreux : évaluation correcte et croisée des enjeux entre adversaires, mesure des effets psychologiques produits par le discours du dissuadeur sur le dissuadé et empathie cognitive réciproque (question du tabou nucléaire notamment), doutes sur l’utilité politique d’une frappe nucléaire massive, qui en soi n’apporte aucune solution au conflit, absence de critère d’évaluation situationnelle à la fois rationnel, objectif, univoque et universel. Les comportements idéaux-types des adversaires attendus par la théorie ne seront jamais garantis par la réalité du conflit.
Voir un jour les puissances dotées renoncer par humanisme à l’atome militaire est une illusion. En revanche, tout système d’arme rencontre un jour sa némésis. Il est permis d’imaginer une alternative à l’apocalypse nucléaire, une dissuasion qui serait plus crédible politiquement tout en disqualifiant l’atome en tant qu’arme, une stratégie qui privilégie directement un choc psychologique massif sans passer par l’intermédiaire d’un anéantissement mutuel.
Une alternative potentielle consiste donc à cibler un bien universel dont la perte nuirait gravement aux éléments vitaux de l’ensemble des États et de la population mondiale ; une perte qui, sans entrainer la fin du monde, ferait régresser l’Humanité pour des siècles ou des millénaires. Cette nouvelle dissuasion repose sur la menace d’interdire l’usage de l’espace circumterrestre via l’envoi depuis la Terre d’un très grand nombre de mines spatiales inertes et indiscriminantes, des objets de petite taille mais dotés d’une grande énergie cinétique (milieu sans frictions), sur des lieux d’étranglement spatiaux (sections d’orbites de 200km à 36 000km d’altitude). Ces mines balaieront toutes les orbites visées jusqu’à la destruction complète de tous les satellites rencontrés et rendront impossible toute exploitation ultérieure de l’espace en créant de vastes nuages de débris permanents (syndrome de Kessler).
Les avantages comparatifs d’une telle alternative à la dissuasion nucléaire sont nombreux. Primo, sa crédibilité politique est renforcée en rendant inutile le recours au suicide collectif. Secundo, l’espace étant un bien commun universel et les mines spatiales étant indiscriminantes, le discours du dissuadeur concerne alors l’ensemble des États (en particulier les plus développés) et pas seulement l’agresseur potentiel. L’intrication de tous les acteurs politico-stratégiques limite donc le risque d’escalade ou de malentendu entre deux adversaires quelconques puisque leur conflit particulier devient d’intérêt général. Au pouvoir égalisateur de l’atome nous substituons le pouvoir intricateur de la mine spatiale. Tertio, l’indiscrimination de la menace renforce le tabou de la frappe en premier et réduit ainsi considérablement le risque d’une course à l’armement. Quatro, le caractère intrinsèquement et exclusivement défensif de la mine spatiale non discriminante confère ipso facto un rôle purement offensif à l’atome militaire. Cela signifie en retour sa totale disqualification comme moyen dissuasif et par là même l’amorce d’un désarmement nucléaire. Quinto, l’exercice de la menace depuis la surface de la Terre évite l’arsenalisation de l’espace. Sa crédibilité technico-opérationnelle est aussi aisément démontrable car facilement simulable au sein d’un milieu transparent. De plus, les conséquences d’un accident de tir sont bien moins graves et l’exercice d’un ultime avertissement à faible altitude est moins sujet à malentendu.
Aussi iconoclaste soit-il, ce modèle alternatif verra son intérêt croître avec le rôle grandissant de l’espace pour les activités humaines et une prolifération lente mais continue de l’armement nucléaire.
Cet entretien est aussi disponible sur MediapartLeClub et sur le site de l’IRIS.