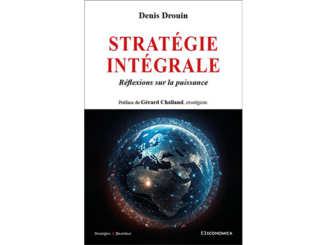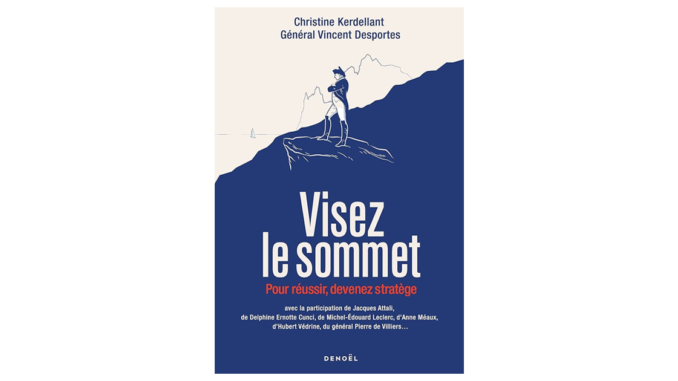
Général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et à HEC, et Christine Kerdellant, rédactrice en chef aux Échos répondent à mes questions à l’occasion de la parution de leur ouvrage Visez le sommet – Pour réussir, devenez stratège aux éditions Denoël.
Le cœur de la stratégie, c’est la liberté d’action ?
À cette question, Xénophon répond d’une phrase : « L’art de la guerre, c’est l’art de garder sa liberté d’action ». Mais on peut aller plus loin. On entre en stratégie parce qu’on en attend des résultats. Churchill se plaisait à le marteler : « Quelle que soit sa beauté, l’important pour la stratégie, c’est qu’elle délivre. » L’art de penser l’action n’a d’intérêt que s’il est possible d’agir, ce qui suppose une certaine liberté. Stratégie et liberté d’action sont ainsi indissociables au point que la seconde est la condition de la première, mais également son cœur. Les grands stratégistes, d’une manière ou d’une autre, s’accordent sur ce point. Le vainqueur de la Première Guerre mondiale, le maréchal Foch, fait du principe de liberté d’action – préserver la sienne, la reconstruire lorsqu’elle s’amenuise, réduire celle de l’Autre – le principe cardinal de la guerre, celui au regard duquel les autres principes semblent des corollaires.
L’objet de la stratégie est de peser sur le cours des événements pour les conduire, malgré les volontés antagonistes, vers l’avenir que le stratège a choisi. Si celui-ci, au lieu de maîtriser l’événement, le subit, il perd sa qualité de sujet pour devenir objet. Il n’est donc plus stratège puisqu’il ne peut plus prendre la main sur le présent, le modeler pour le conduire vers le futur choisi : le lien entre stratège et liberté est indissoluble.
Par conséquent, agir stratégiquement, c’est déterminer son espace de liberté, le préserver et l’agrandir dans un jeu à somme nulle afin de restreindre celui de l’Autre jusqu’à le faire disparaître.
Au fond, « Ne pas subir », la belle devise du maréchal de Lattre, résume l’esprit du stratège. De Thucydide à nos jours, la liberté d’action s’inscrit au cœur de la stratégie, conflit des libertés visant des ambitions concurrentes. Le principe de liberté d’action est même le seul principe véritablement universel et intemporel. Ne le retrouve-t-on pas dans toutes les cultures stratégiques ? L’Indien monte ses embuscades dans les canyons, là où la liberté d’action des tuniques bleues est réduite. La partie est perdue aux échecs dès que le roi est privé de toutes ses libertés de mouvement. Le joueur de go recherche des positions qui accroissent sa capacité d’initiative et conquiert le goban en réduisant un à un les degrés de liberté des pierres de son adversaire…
André Beaufre propose une synthèse de ces réflexions : « La stratégie est l’art de la dialectique des volontés employant la force pour régler leur conflit. La lutte des volontés se ramène à une lutte pour la liberté d’action. Le combat pour la liberté d’action est donc l’essence de la stratégie, chacun cherchant à la conserver et à en priver l’adversaire, cette lutte incessante pour la domination en termes de liberté d’action se jouant à somme nulle. La protection de sa propre liberté d’action et l’aptitude à priver l’adversaire de la sienne constituent les bases du jeu stratégique[1]. »
Pour autant, aucune règle, aucune stratégie ne soldera définitivement le problème de la liberté d’action de l’Autre, laquelle demeurera éternellement le défi majeur de celui qui entre en stratégie.
Peut-on être stratège en période de mondialisation qui a accéléré le temps en réduisant l’espace ?
Effectivement, l’accélération constante de la vie sous l’effet des moyens modernes de communication, et l’abolition des distances conduisent les décideurs de plus en plus accaparés par l’immédiat à sacrifier le futur au présent. Parallèlement, les réalités et les mirages de la science poussent à rechercher dans la technologie les remèdes aux angoisses stratégiques. Notre certitude est pourtant que seules la prise de recul et la stratégie peuvent conduire les projets humains là où le leader souhaite les mener. Il nous faut entrer en stratégie !
Mais, dira-t-on, faut-il vraiment s’intéresser à la stratégie dans ce monde toujours plus complexe, où prévoir semble de plus en plus illusoire ? Nous n’en doutons pas : c’est la voie du succès pour tous ceux qui, au nom des autres, portent des responsabilités. Portant loin, la stratégie construit le sens de l’action, forge une indispensable stabilité pour l’exécution des projets, redonne sens au chaos forgé des interactions humaines et de l’entremêlement des circonstances.
Nombreux pourtant sont ceux qui se réfugient dans la facilité du court terme : les bouleversements fréquents et inattendus du monde leur ont fait perdre le goût de la perspective. À quoi bon vouloir demain ? Nous ne savons pas ce qu’il sera et nous ne maîtrisons aucune des voies pour l’atteindre. La stratégie suppose la conscience du temps long alors que nous sommes toujours davantage happés par les impératifs du court terme.
Plutôt que de s’atteler à l’exigeante tâche de la conception stratégique, ne serait-il pas effectivement plus simple de se laisser porter par les courants et d’attendre ce que l’avenir voudra bien nous donner ? Devant l’incertitude de l’environnement, la tentation est grande de tirer un parti immédiat des circonstances du moment, de suivre la tranquille « politique du chien crevé au fil de l’eau » en glanant ici et là les fruits trompeurs de la contingence.
Ainsi, si l’on n’y prend garde, la tentation du court terme frappe. Partout. Sauf exception, le politique se consacre d’abord au succès des prochaines élections. Il délaisse le long terme qui, quoi qu’il arrive, ne lui appartient pas et ne lui profitera pas ; il abandonne aisément les grands principes pour les petits choix et les faciles arrangements. La focalisation se fait sur les questions locales de court terme où des progrès tangibles peuvent être produits au cours des cycles électoraux. On promet beaucoup pour l’avenir – on y rasera gratis ! – mais on ne le construit pas, puisqu’il sera celui des autres.
L’entrepreneur succombe à la même obsession. Les patrons de petites ou moyennes entreprises, peu secondés, sont accaparés par leur quotidien qu’accélèrent les flux croissants d’information. Ceux des grandes entreprises cotées, obsédés par la dictature des résultats trimestriels, sont facilement victimes de « myopie managériale » ; ils privilégient les bénéfices rapides au détriment de la création de valeur à long terme. L’actionnaire, souvent anonyme, attend des résultats immédiats dont l’absence le priverait de revenus et dégraderait le cours de bourse. Les responsables sont jugés et remerciés sur leur capacité à mettre en œuvre de soi-disant stratégies… dont les résultats sont évalués toutes les douze semaines !
Les managers ont ainsi graduellement laissé le rendement immédiat supplanter la stratégie : l’efficacité – de long terme en particulier – est oubliée au profit de l’efficience qui enferme les acteurs dans des processus normés, prive l’organisation de leurs intelligences, de leurs capacités d’initiative et d’adaptation. Recherchant l’optimisation de la chaîne de valeur et l’amélioration pointilleuse des processus qui la structurent, les organisations vivent un engrenage mortifère. Assoiffées de plans et de chiffres, elles se surchargent de process, de protocoles, d’indicateurs clés de performance. L’obsession de la performance immédiate se transforme en cécité puis se retourne contre elle-même : elle produit finalement de l’inefficacité et de l’inefficience. Le seul objectif assigné aux modèles opérationnels devient la réduction des coûts.
Oublieuse de stratégie, la rationalisation à outrance devenue fin en soi n’est pas sans conséquence. L’obsession des résultats immédiats rend difficiles la prise de recul et la remise en cause. L’esprit tactique s’impose et la technique finit par dominer. Le technocrate fournit les indiscutables solutions qui ont « fait leurs preuves ». Il faut répondre, riposter plus que construire pour demain. Le réflexe l’emporte sur la réflexion ; le décideur, qui doit pourtant « mettre de l’avenir » dans chacune de ses décisions, oublie que la stratégie est l’art du questionnement.
N’en doutons pas : plus le monde semble étourdi de son accélération constante, plus il faut entrer en stratégie. Aussi réfractaire soit-elle à la démarche théorisante, aussi éloignée paraisse-t-elle des préoccupations immédiates, il est indispensable de penser la stratégie parce qu’elle seule permet de dépasser la confusion dans laquelle l’action humaine est contrainte de se déployer. Il n’y a pas de substitut à la pensée stratégique : voilà la conviction qui nous a animés dans la conception de « Visez le sommet ».
Pas de stratégie sans désir d’avenir ?
Le point de départ du stratège, c’est imaginer un avenir et y croire : avoir un désir de changement, la foi dans sa capacité à le réaliser … et une vraie volonté ! La stratégie est un anti-fatalisme. La mise en mouvement stratégique, c’est d’abord un futur auquel on aspire, un destin que l’on entend maîtriser. Un désir d’avenir : voilà le premier ingrédient de la stratégie, sa condition et sa raison profonde. Il est le point d’ancrage du stratège qui n’extrapole pas le présent mais « rétra-pole » le futur, en le plaçant au cœur de chacune de ses décisions.
La nécessité de se projeter dans l’avenir est donc le déclencheur, l’ingrédient initial. Il naît d’une prise de conscience : la stagnation est synonyme de disparition, le court-termisme est un danger mortel. Je dois avancer et je dois vouloir. La stratégie suppose un projet positif, une « intention stratégique » qui en est le catalyseur, le guide et l’objectif. Sans but à atteindre, impossible de concevoir une stratégie, puisque à partir de cette ancre, par un processus de rétro-construction, la stratégie organise la définition des voies et la mise en œuvre des moyens.
Mais cette finalité créatrice est bien plus encore. Elle transforme un groupe humain en entité stratégique, en collectif de femmes et d’hommes choisissant d’aller au même endroit. C’est ce qui les rassemble et les différencie de la foule, cette masse d’individus sans objectif commun. Le collectif sera d’autant plus puissant que l’adhésion de chacun à la finalité commune le sera, ce qui fait de la finalité non seulement l’élément fondateur de la stratégie mais également un outil puissant de management des équipes. « Celui dont les troupes sont unies autour d’un objectif commun sera victorieux[2]», affirmait déjà Sun Tzu.
Quand moi, stratège, je définirai cette finalité, je dois savoir que sa formulation elle-même aura un impact sur son devenir : sera-t-elle un atout ou un frein pour ma stratégie ? Un catalyseur d’énergies, un aimant polarisateur des initiatives, ou un concept inerte voire démotivant ? Je devrai m’interroger sur l’adhésion des membres de mon entité : la finalité choisie ne devra pas demeurer la mienne mais devenir celle du plus grand nombre. Plus mes partenaires et collaborateurs s’approprieront cet objectif, plus ils s’engageront. Alors la finalité commune deviendra le fil directeur, la boussole, le nord stratégique de l’entité. Et en tant que leader stratégique, je n’aurai plus à être inquiet : quelles que soient les difficultés, mes partenaires « engagés » seront guidés par cette étoile accrochée à leur ciel et orienteront spontanément leurs actions dans sa direction. La vision ne doit pas être imposée d’en haut : pour jouer son rôle, elle doit emporter l’adhésion et, partant, être le début d’une histoire à vivre ensemble. D’où l’importance du récit, cet outil puissant qui vise non la rationalité, mais le cœur, d’où procède la vraie adhésion : pas de grande idée qui ne soit partagée, pas de vision efficace, tisseuse de lien, sans une narration qui permette d’en faire une force commune.
Le stratège réfléchit en architecte, fait de son ambition – devenue commune par la puissance du récit – son horizon, fédère les énergies, affronte les difficultés et s’adapte aux circonstances, en gardant le regard rivé sur la grande idée qui le fait avancer ; il se transforme sans changer d’objectif, pour mieux l’atteindre. C’est toute la différence entre le tacticien et le stratège : le premier construit le futur à partir du présent, brique après brique, et ce futur est le fruit des circonstances plus que la traduction de sa volonté. Le second, à l’inverse, construit le présent à partir du futur qu’il a voulu. Porteur d’un grand dessein, il le veut avec force et le dessine. Il n’atteint d’ailleurs l’attitude stratégique que s’il se pose sans cesse la question du sens et met naturellement du futur dans chacune de ses décisions.
Douter toujours, n’hésiter jamais ?
Effectivement, le stratège doit savoir douter ! Le décideur ne peut en effet être stratège que s’il reconnaît les spécificités de sa prise de décision : connaissance imparfaite de ses constituants, compréhension circonstancielle des événements, absence de règles sûres pour fonder son raisonnement, vérités forcément partielles, relatives et temporaires… donc une « rationalité limitée » qui fera de sa décision un « pari » fondé sur des hypothèses. Jamais de « certitude stratégique » : c’est un oxymore ! Le stratège doit donc rester modeste : il peut, au mieux, avoir fait des choix satisfaisants, apparemment rationnels. Mais il a en réalité fait confiance à son intuition, et doit donc être capable de remettre ses choix en question, sans les tenir jamais pour définitifs. Il doit « douter » toujours, au sens cartésien du terme.
Ce doute stratégique n’est pas un doute de frilosité et d’hésitation : il est un doute de principe, méthodologique, qui admet tant l’imperfection des instruments d’observation et d’interprétation, que la « liberté de l’Autre ». Comme la science, la pensée stratégique progresse par doute, raisonnement, expérience, observation et intuition ; elle est le fait de l’être humain supérieur, capable tout à la fois « de penser une chose et son contraire », pour paraphraser Pascal.
En recul volontaire par rapport à ma décision dont je sais qu’elle est le fruit contingent de l’instant et des circonstances, je l’observe et n’en suis point prisonnier, conservant à tout moment le courage intellectuel de la remise en cause. Une fois prise, elle devient un objet qui n’est plus moi : je l’observe dans son environnement, évaluant en permanence l’écart d’une part entre la perception de la réalité qui me l’a fait prendre et celle qui se développe, et d’autre part entre les résultats que j’en attendais et ceux qui émergent. Pour parler philosophie, j’oppose aux dogmatiques et idéologues mon scepticisme constructif, celui qui, ne tenant rien pour vrai ou pour faux, réexamine sans cesse les prémisses de son raisonnement. Pour parler mathématiques, je sais qu’une décision est une variable discontinue qui traite d’un problème continu – l’évolution de l’univers stratégique – et que, inexorablement, l’inadaptation de ma décision à cet univers va croissant. Donc moi, stratège, je remets en question mes données et jugements initiaux, je « doute » pour avancer, n’ignorant pas que le suprême triomphe de la raison est de jeter le doute sur sa propre validité. Contrairement au tacticien concentré sur la recherche de « la » bonne réponse, nous savons que la stratégie est d’une autre nature : elle est l’art du questionnement.
Ainsi, le stratège « doute », esprit et sens aux aguets, mais il croit, donc n’hésite pas. Pas de stratège qui n’ait foi en lui-même, en sa légitimité à conduire son entité stratégique, en la fiabilité de son intuition.
[1] André Beaufre, Introduction à la stratégie, op. cit. p.184
[2] Sun Tzu, L’Art de la guerre, op. cit.
Cet entretien est aussi disponible sur le site de l’IRIS et MediapartLeClub.