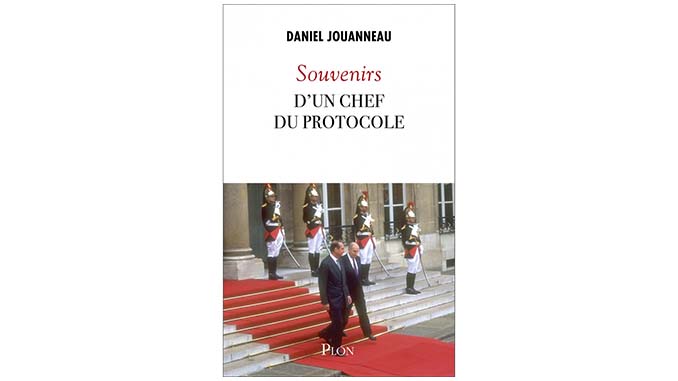
Daniel Jouanneau, diplomate et chef du Protocole sous les présidents François Mitterrand et Jacques Chirac, répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Souvenirs d’un chef du protocole » aux éditions Plon.
Sans protocole, pas de diplomatie ?
Le protocole est aussi ancien que les États et sert depuis des siècles à organiser leurs relations, pour qu’elles se déroulent de la façon la plus harmonieuse possible. Dès le Moyen-âge, le roi fixait lui-même le cérémonial d’accueil des souverains étrangers. La fonction d’introducteur des ambassadeurs a été créée par Henri III. Le protocole est au service de la politique étrangère. En France, depuis le Second Empire, le chef du Protocole a toujours été un diplomate.
Le protocole est fait de règles claires, codifiées et acceptées par tous, certaines remontant au congrès de Vienne de 1815, comme celle de l’égalité des États. Qu’il représente un très grand ou un tout petit pays, un ambassadeur prend rang selon la date de sa prise de fonctions. La convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques a donné une valeur universelle aux privilèges des diplomates (fiscaux, douaniers) et aux immunités, strictement définies, auxquelles ils ont droit pour être à l’abri des pressions de leur pays d’accueil.
Chaque État apporte au protocole ses traditions et sa marque propre. Par exemple, une visite d’État à Londres commence par un trajet en calèche. En Corée, elle débute par une cérémonie au cimetière national devant un brûle-encens. En France, une seule et même unité, la Garde républicaine, rend les honneurs d’un bout à l’autre de la visite. Le degré d’apparat donné à une visite (visite de travail, visite officielle, visite d’État) est fonction de l’importance politique qui lui est attachée. Cette classification fait partie de la négociation qui accompagne toute rencontre entre chefs d’État.
Le protocole, c’est à la fois un code strict et une capacité permanente d’improvisation ?
Le protocole s’appuie sur des principes universels et quelques textes nationaux (en France, le décret de 1989 sur les préséances). Tout est préparé le plus en amont possible dans un grand degré de détail, vérifié et revérifié, mais il y a souvent des imprévus : un changement de programme au dernier moment, une délégation différente de celle annoncée, un besoin d’interprète inattendu. Le chef du Protocole et son équipe doivent trouver instantanément la bonne réponse.
Les protocoles français et américain sont-ils très différents ?
En France, le chef du Protocole a une position très privilégiée : il assure à la fois le protocole du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement – alors que dans de nombreux pays le chef de l’État a un chef du protocole et le ministère des Affaires étrangères en a un autre. Il dirige une équipe dont une partie est au Quai d’Orsay et l’autre à l’Élysée. Pour l’organisation des activités internationales du chef de l’État, il a un pouvoir de coordination sur le petit groupe interministériel et multimétiers avec lequel il travaille au quotidien : aides de camp, presse, communication, sécurité, logistique, service de santé des armées. Il est un des directeurs du ministère des Affaires étrangères, avec accès direct au Président de la République.
Le chef du Protocole de la Maison Blanche est dans une situation beaucoup moins favorable. Il n’a aucune compétence pour organiser les déplacements internationaux du président des États-Unis ni les visites des chefs d’État étrangers. C’est la mission du Secret service, sécurité rapprochée du président, très autonome, ne relevant que de lui, mais décidant souverainement de ce qui est acceptable ou non en fonction du risque pour sa sécurité. L’assassinat de John Kennedy et la tentative d’attentat contre Ronald Reagan ont fait de ce service une entité très puissante, y compris lorsque le président se déplace à l’étranger et que sa sécurité est assurée par le pays qui l’accueille.
À Washington, le chef du Protocole, en général un ami personnel du président, est là pour d’organiser les réceptions, gérer les invitations et préparer les plans de table.
La réforme du protocole voulue par Jacques Chirac – les voitures des autorités s’arrêtent aux feux rouges et ces dernières prennent des avions de ligne – n’a pas duré très longtemps ?
Lorsqu’il a pris ses fonctions à l’Élysée, Jacques Chirac considérait que le second septennat du président Mitterrand avait été marqué par une « dérive monarchique ». Élu sur le thème de la « fracture sociale » il voulait, pour le président et pour les plus hautes autorités de l’État, un protocole plus simple. Il décida que les présidents des Assemblées et les ministres se déplaceraient dans Paris en s’arrêtant aux feux rouges et interdit gyrophares et deux-tons. Pour ses déplacements à l’étranger, son intention était de prendre les vols de ligne, et il décida de dissoudre le GLAM, parc présidentiel de l’armée de l’air. Il remplaça la grande escorte à cheval de la Garde républicaine par une escorte motocycliste. À l’expérience, il se rendit compte qu’il n’était pas réaliste de renoncer aux vols spéciaux pour les visites officielles et, à l’exception, en tout début de mandat, d’un voyage en Concorde pour rendre visite à Bill Clinton, Jacques Chirac renonça à cette fausse bonne idée. Le GLAM réapparut rapidement sous un autre nom et, comme le faisait son prédécesseur, le président utilisait couramment le Falcon 900. La grande escorte à cheval fut rétablie par la suite, le roi du Maroc, invité en visite d’État, ayant fait savoir qu’il y tenait beaucoup…
L’arrêt aux feux rouges a été assez vite oublié, mais les cortèges sont moins bruyants. Comme l’avait décidé Jacques Chirac sur l’insistance du préfet de police, la moitié seulement des Champs-Élysées, et non plus l’avenue sur toute la largeur, est coupée lorsqu’un chef d’État va fleurir le tombeau du Soldat inconnu.
Cet article est également disponible sur mon blog.
