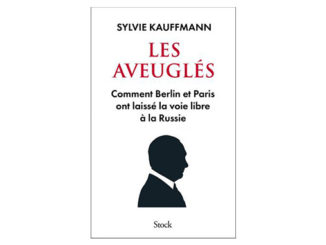Francis Wurtz, ancien député communiste au Parlement européen, préside l’Institut d’études européennes de l’université Paris VIII et enseigne les enjeux européens à IRIS Sup’.
- Vous avez été parlementaire européen pendant 30 ans, apprécié et respecté bien au-delà de votre famille politique. Vous avez été extrêmement influent dans la détermination de la politique européenne du PC. Êtes-vous inquiet du prochain résultat des élections européennes ?
Je ne cacherai effectivement pas mon inquiétude au vu des évolutions politiques observables dans la plupart des pays membres, France comprise. A mes yeux, les politiques et les pratiques en vigueur dans l’Union européenne sur une longue période portent à cet égard une lourde responsabilité dans cette situation. La construction européenne a, de nos jours et dans le contexte actuel, comme principale raison d’être, celle de protéger ses citoyens et ses résidents en général contre les effets pervers de la mondialisation libérale, et d’user de son poids et de son influence pour réguler et humaniser les relations internationales. Au lieu de cela, elle s’est, pour l’essentiel, coulée dans ce néolibéralisme ambiant. Toutes les tentatives progressistes et constructives de faire changer l’UE de cap – depuis le référendum français sur le projet de traité constitutionnel de 2005 jusqu’au vote massif des Grecs pour un traitement plus humain en 2015 – ont été ignorées ou étouffées dans l’œuf. Désormais, ce sont des forces régressives et anti-européennes qui risquent dans bien des cas de récupérer le mécontentement et les frustrations accumulées. Un bref regard rétrospectif éclaire les raisons du fiasco actuel.
Le premier grand basculement dans le grand bain néolibéral s’est produit au tournant des années 1980-1990. Il est significatif que la libre circulation des capitaux – sans harmonisation ni fiscale ni sociale préalable – a été instituée en 1990 alors même que le traité de Rome de 1957 la prévoyait déjà, mais sans jamais l’imposer jusqu’alors. Dès que les rapports de force internationaux l’ont permis – le capitalisme triomphant à la suite de la disparition du système soviétique – toute une série de mesures phares du néolibéralisme a été lancée (ouverture des entreprises publiques de service public à la concurrence ; libéralisation des marchés publics ; rationnement des dépenses publiques grâce au Pacte de stabilité, etc.). Le « consensus implicite » sur lequel reposait l’équilibre européen a commencé à s’éroder avec le traité de Maastricht.
Une deuxième césure intervient selon moi au moment du grand élargissement à l’Est, au début des années 2000. Non en raison de l’arrivée de ces pays en elle-même, mais du fait de la conception de cette transformation qui a prévalu, à savoir l’instrumentalisation des différences sensibles de niveau de développement entre Est et Ouest pour organiser la mise en concurrence des modèles sociaux et tirer les acquis des pays socialement plus avancés vers le bas : c’est là une source inépuisable de frustrations à l’ouest de l’UE. Mais les dégâts de cette adhésion en bloc, sur la base de « négociations » ne tenant pratiquement aucun compte de la rupture sociétale que représentait pour les peuples concernés ce saut brutal dans le capitalisme, ne se sont pas produits qu’à l’ouest ! Jamais n’a été posée aux pays candidats la question-clé : « Que voulons-nous faire ensemble ? » Il n’est dès lors guère étonnant de constater le désarroi grandissant dans la population de la plupart des pays d’Europe de l’Est, qui plus est, sauf exception, sans tradition démocratique.
La troisième fuite en avant néolibérale, la plus grave de conséquence, est la gestion calamiteuse de la crise de la zone euro à partir de 2010. La « nouvelle gouvernance économique » – l’avalanche de règlements : « sixpack », « two pack » et « Pacte budgétaire » – ont non seulement institué les politiques d’austérité à perpétuité, mais ont mis en place un mécanisme coercitif effarant de bureaucratie et totalement inacceptable sur le plan démocratique (« semestre européen »). Angela Merkel a appelé cela la « Marktdemokratie », la démocratie intégrant les impératifs des marchés ! Et tous ses « partenaires » ont suivi ! Le summum de cette dérive est le sort cruel et humiliant (avec les « hommes en noir » de la « troïka ») réservé aux pays « sous assistance » financière, le cas de la Grèce dépassant de ce point de vue les limites de l’imaginable. Nous payons aujourd’hui ces choix d’une totale irresponsabilité, avec une UE fracturée et une crise de confiance sans précédent. Voilà pourquoi je suis inquiet, mais résolu à poursuivre mon engagement pour une refondation démocratique de l’Union européenne.
- Quels avantages voyez-vous dans l’Euro, puisque vous vous exprimez contre la sortie de la France ?
Une sortie de l’euro entraînerait une cascade de dévaluations compétitives, c’est-à-dire une régression sociale doublée d’une montée des antagonismes entre anciens partenaires : ce serait le contraire d’une solution ! Le statu quo n’est pas non plus acceptable : la BCE a concédé aux banques de la zone des prêts à long terme d’un montant de 750 milliards d’euros, qui commenceront à arriver à échéance en 2020. Avec quel bilan en matière d’emploi, de formations, de transition écologique, de productions utiles, de services publics ? Pas brillant ! Elle aurait pourtant toute capacité de favoriser des investissements répondant à ce type de besoins, par un crédit sélectif (réserver son soutien aux banques pour les crédits orientés vers la création de richesses utiles à la société et pénaliser ceux qui, au nom de la seule obsession de la rentabilité financière, tournent le dos à ces critères). C’est le sens de la bataille à mener, à mes yeux, pour une autre coopération monétaire : utiliser les formidables capacités de la BCE à créer de l’argent pour orienter le crédit vers la promotion des capacités humaines, la transition écologique et la participation au financement des biens communs mondiaux.
- Pourquoi êtes-vous opposé à des sanctions contre la Russie ?
La sécurité collective sur le continent européen passe par un dialogue politique et une coopération approfondie avec la Russie. Cela ne vaut pas approbation de la politique de Vladimir Poutine : dans les années 70, les Occidentaux et les Soviétiques appartenaient à des systèmes politiques antagonistes, et ils ont néanmoins organisé en commun la Conférence d’Helsinki pour la sécurité et la coopération en Europe ! Qu’attend-on pour ouvrir des discussions en vue d’un traité paneuropéen de sécurité ? L’ex-Président Medvedev l’avait officiellement proposé en mai 2008. L’UE n’avait donné aucune suite, de peur de devoir demander à l’OTAN de stopper son élargissement vers l’Est et l’installation du « bouclier anti-missiles » dirigé contre Moscou ! Il faut savoir ce que l’on veut : l’allégeance sans condition aux États-Unis ou la sécurité sur notre continent.
- La réponse européenne à Trump vous parait-elle satisfaisante ?
Non, justement ! Voilà un « allié » qui traite l’Europe d’« ennemie », impose aux Européens l’extraterritorialité du droit américain, tente de torpiller l’accord mondial sur le climat, envenime gravement les tensions au Proche-Orient au mépris du droit international, retire les États-Unis du traité international sur les forces nucléaires intermédiaires …sans que cela conduise les dirigeants européens à tirer les conséquences de ce renversement stratégique ! Il y a, certes, la relance de la « défense européenne », mais elle s’élabore en coopération étroite avec l’OTAN… Et sur le plan économique, l’affirmation brutale de l’ « America first » et les menaces de guerre commerciale n’empêchent pas les dirigeants européens de compter sur la fermeté de Washington vis-à-vis de la Chine ! Ce serait, au contraire, le moment de s’émanciper de la tutelle des États-Unis et, le cas échéant, de jouer à fond la carte du multilatéralisme en recherchant le plus d’alliés possibles pour jeter les bases de relations internationales plus solidaires, plus coopératives et plus pacifiques : bref, d’affirmer une ambition à la mesure des urgences économiques, climatiques et sécuritaires de notre époque.
Cet article est également disponible sur le club Mediapart.