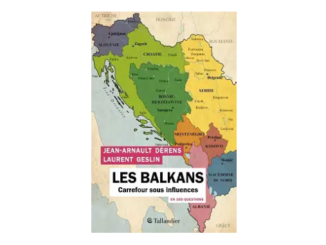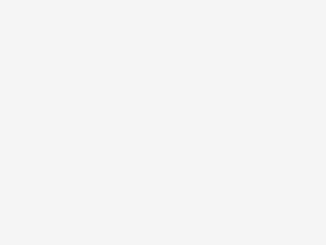Les Occidentaux répètent régulièrement qu’ils sont unis par des valeurs communes : démocratie, respect des droits de l’homme, égalité hommes/femmes, respect des minorités, indépendance de la justice et liberté d’opinion, de la presse et de la religion. Ils aiment s’en prévaloir tout en faisant la leçon aux nations qui ne les respecteraient pas, oubliant parfois que leurs indignations sont sélectives ou leurs principes à géométrie variable. Leur sévérité dépend de la nature des relations qu’ils entretiennent avec les prétendus coupables, plus que de la gravité des faits reprochés. Les États rivaux ont davantage de chance de se faire sermonner que les États alliés ou clients. Il leur arrive par ailleurs de déroger au respect de ces valeurs autoproclamées occidentales, affaiblissant la crédibilité de leurs discours.
Mais, au-delà de ces éventuelles contradictions, il existe bien un corpus de valeurs occidentales, identifiées et revendiquées, qui unit les pays des deux rives de l’Atlantique. Leur différence fondamentale réside en l’adhésion pour l’un, et le rejet pour l’autre, d’une vision, qui devrait, face aux grands défis internationaux, occuper une place de plus en plus centrale dans la vie internationale : le multilatéralisme.
Le multilatéralisme n’est pas rendu nécessaire par l’émergence d’un monde multipolaire, mais par celui d’un monde de plus en plus interdépendant. Aucun grand défi auquel est confrontée l’humanité ne peut être résolu par des moyens uniquement nationaux. Seule une coopération à grande échelle, donc une politique multilatérale, permet de faire face au réchauffement climatique, aux risques terroristes, aux défis démographiques, à un accès facilité aux biens publics mondiaux, ou à la mise en place d’un véritable système de sécurité internationale.
Mais, si l’Union européenne a inscrit le multilatéralisme dans son ADN, les États-Unis y sont réfractaires. Ce rejet a des racines anciennes et profondes. Se croyant – et étant à bien des égards – exceptionnels, les États-Unis ont du mal à concevoir une action basée sur la volonté collective, où ils ne seraient qu’un parmi d’autres. Persuadés, depuis longtemps, de leur « destinée manifeste », ils sont tout à fait à l’aise avec l’idée de guider un monde régi par l’unilatéralisme, qui ne saurait que conduire à des résultats positifs. Avant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient isolationnistes. Ils en sont sortis plus puissants que tous les autres acteurs du conflit et ont pris « la tête du monde libre ». N’ayant jamais eu l’habitude de traiter avec des égaux, sauf peut-être durant la brève période Nixon-Kissinger, ils ne furent jamais confrontés à la nécessité d’une diplomatie entre puissances équivalentes. À la fin du monde bipolaire, ils préférèrent ainsi se considérer comme les vainqueurs de la guerre froide plutôt que comme les bâtisseurs d’un nouvel ordre mondial.
C’est un président considéré comme multilatéraliste, Bill Clinton, qui a pu déclarer que les États-Unis étaient la « seule nation indispensable ». L’unilatéralisme américain n’a pas démarré avec Georges W. Bush et l’après 11 septembre, pas plus qu’avec D. Trump. Il est le fondement de leur politique extérieure. Barack Obama l’avait réduit, mais ne l’a pas éliminé. Donald Trump le pousse à son paroxysme. Mais son successeur, quel qu’il soit, n’abandonnera pas cette posture ; il la modulera.
Ce comportement, enraciné dans les perceptions, les modes de pensées et les traditions de l’action, est l’un des défis majeurs posés aux Européens. Au moment où le multilatéralisme est plus nécessaire que jamais, comment traiter avec une nation qui s’en méfie, et le considère comme une contrainte inutile plutôt qu’un moyen d’action indispensable ? L’Europe doit s’affirmer comme une puissance, mais une puissance multilatéraliste.
Cet article est également disponible sur Mediapart Le Club.