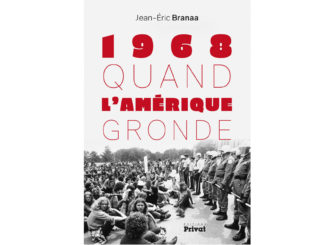Le système de défense antimissile américain déployé en Europe constitue une des (si ce n’est la) principales pommes de discorde entre Moscou et Washington, et ce depuis plus d’une vingtaine d’années. Sa mise en place en Asie, accélérée par la crise nord-coréenne, risque également d’envenimer les relations entre Pékin et Washington.
L’histoire de la défense antimissile fut un sujet de préoccupation majeure de la guerre froide. Dans les années 1960, l’URSS, inquiète de la supériorité nucléaire des États-Unis, commença à déployer un système antimissile, destiné à la protéger d’une éventuelle attaque américaine. Les États-Unis, en mettant en place le même type de programme, n’ont alors fait « que » suivre. Très rapidement, les deux protagonistes prirent conscience des risques d’une telle course aux armements, qu’ils soient offensifs ou défensifs.
Cette course sans fin épuise ses participants, qui souhaitent doubler l’autre en permanence, sans réellement connaître leurs propres positions. Pour les armes offensives (les missiles), elle est une compétition interminable dont on connaît la ligne de départ, mais pas celle d’arrivée. Pour les armes défensives (les missiles antimissiles), elle n’offre que l’illusion d’une invincibilité : rechercher la sécurité absolue amène l’insécurité absolue, comme l’a correctement diagnostiqué Henry Kissinger.
Le traité SALT 1, signé en 1972 (apogée de la détente), fixe un unique plafond aux nombres d’armes offensives que chacune des deux superpuissances peut posséder. Il en fixe également aux armes défensives : deux sites de cent lanceurs, qui seront ultérieurement réduits à un seul.
Dans les années 1980, la « guerre des étoiles » (initiative de défense stratégique), lancée par le président américain, Ronald Reagan, relance le projet. Il s’agissait de mettre en place un système de satellites, dans l’espace ou sur la Terre, qui détruiraient les missiles ayant pour cible le territoire américain. Fondé sur l’argumentation « plutôt défendre que venger ses morts », il oubliait que le but de la dissuasion nucléaire était d’empêcher le début d’une attaque. De plus, le système ne peut être assuré de fonctionner à 100% et il ne faut pas plus d’un missile atteignant sa cible pour que les conséquences soient irréversibles. Malgré un gigantesque financement (26 milliards de dollars rien que pour la recherche et le développement), le programme n’apparaissait pas comme réaliste. De plus, il relançait la course aux armements, dans l’espace et au sol, car, face au déploiement du système défensif américain, les Soviétiques ne pouvaient que multiplier leur propre déploiement d’armes offensives… À l’époque, François Mitterrand fut le seul président occidental à mettre en garde contre le caractère illusoire et stratégiquement déstabilisant du programme.
Dans les années 1990, Bill Clinton déterra le projet afin de faire face à la menace nord-coréenne. Au début du XXIe siècle, c’est la menace iranienne qui explique qu’il soit à nouveau placé au cœur de la politique américaine. La même argumentation était à chaque fois mise en avant : désormais, technologiquement possible et financièrement supportable. Argumentation à chaque fois démentie par les faits.
Ainsi, régulièrement, ce type de programme est relancé. Ce dernier, fétiche du complexe militaro-industriel, se qualifie de « défensif », supposé être davantage « vendeur » auprès des opinions publiques. La sagesse dont ont su faire preuve Richard Nixon et Henry Kissinger n’a plus cours. Dans son livre, Un nouvel avant-guerre, Andreï Gratchev raconte qu’au sommet d’Helsinki de 1986, R. Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ont failli se mettre d’accord sur un programme de désarmement nucléaire général et complet. Le premier y a renoncé au dernier moment, car cela aurait signifié la fin du laboratoire mis en place par sa « guerre des étoiles ». Dans ses mémoires, Madeleine Albright écrit qu’un accord de démantèlement du programme nucléaire nord-coréen aurait été possible en 2000, s’il avait pu résister aux protestations des partisans du système de défense antimissile.
En 2001, Georges W. Bush s’est retiré du traité ABM (anti-ballistic missile) afin de travailler librement sur un programme de système de défense antimissile. À ce jour, seuls les États-Unis et la Corée du Nord (TNP) se sont retirés d’un accord de désarmement nucléaire.
Pour Moscou, la dénonciation du traité et la mise en place d’un système de défense antimissile en Europe constituent une atteinte à la parité nucléaire. Barack Obama en était conscient et, lui qui prétendait ne pas vouloir déployer « un système basé sur des technologies incertaines et un financement non assuré contre une menace inexistante », a plié devant le complexe militaro-industriel. Il n’a donc pas pu appuyer sur le bouton reset des relations américano-russes. Donald Trump, considéré comme le plus « iconoclaste » des présidents américains, ne peut pas non plus mener une politique de rapprochement à l’égard de la Russie, malgré ce qu’il déclarait lors de sa campagne électorale.
On se trouve face à l’immense paradoxe d’un programme présenté comme défensif, mais qui est, en réalité, menaçant et suscite de l’incertitude stratégique. C’est sans doute l’objectif du complexe militaro-industriel américain, soucieux d’éviter le piège de la détente et du désarmement.
Vous pouvez également retrouver cet article sur mon blog Mediapart.