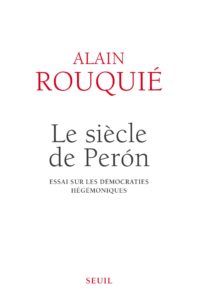Ambassadeur de France au Brésil de 2000 à 2003, Alain Rouquié est Président de la Maison de l’Amérique latine. Directeur de recherche émérite à la Fondation nationale des sciences politiques, il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Le siècle de Perón : Essai sur les démocraties hégémoniques » aux éditions du Seuil.
Perón a été élu deux fois (1951, 1973) avec des marges fortes et, depuis le rétablissement de la démocratie, seuls les candidats se réclamant de son héritage ont pu terminer leurs mandats. Comment s’explique cette « étrange pérennité » ?
La longévité et l’étrange survie du péronisme doivent autant à la politique de ses adversaires qu’à sa nature organisationnelle et idéologique. Au point de départ, le colonel Juan D. Perón, admirateur de Mussolini, qui craint une explosion sociale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, organise la classe ouvrière née de l’industrialisation au sein de syndicats uniques étatisés sur un modèle corporatiste. Ces syndicats verticaux qui ignorent les procédures démocratiques constituent l’épine dorsale du mouvement péroniste. Ils tirent initialement leur légitimité des lois sociales généreuses et sans précédent en Argentine que Perón a fait promulguer.
Lorsque Perón est renversé par un coup d’État militaire en 1955, le parti péroniste est interdit. Les péronistes sont proscrits mais contrôlent toujours les syndicats qui conviennent au patronat. L’Argentine connaît de multiples coups d’Etat (1962,1966,1976) qui visent à « dépéroniser » la vie politique et sociale. Mais, alors qu’ils suspendent tous les partis politiques, les régimes militaires qui en sont issus se gardent de réformer ou de démanteler les organisations professionnelles, auxquelles ils donnent ainsi le monopole de la représentation politique et sociale.
En outre, la proscription électorale du péronisme ne fait que confirmer sa prétention majoritaire. Elle suppose en effet que s’il était autorisé, il retrouverait légalement le pouvoir. C’est ce qu’il se produit d’ailleurs en 1973. Ainsi s’est créée une culture politique anti-libérale dans laquelle le peuple argentin serait par nature majoritairement péroniste. Les transformations successives du mouvement et ses tactiques contradictoires lui ont permis d’occuper tout le spectre politique. La déstabilisation des gouvernements qui ne se réclament pas de cet héritage découle de cette situation singulière.
Perón a accueilli un large spectre idéologique allant du castrisme au fascisme. Comment expliquer qu’après lui la gauche ait été chassée de la vie politique argentine ?
Perón est le créateur dans les années 1940 du welfare state argentin. Parallèlement, il a réorganisé les syndicats en les épurant, c’est-à dire en chassant de leurs directions les partis de gauche. À l’élection de 1946, socialistes et communistes ont choisi contre le candidat Perón, jugé « totalitaire et pro-nazi », de soutenir une alliance démocratique avec les libéraux et les conservateurs. Les partis de la « classe ouvrière » coupés de celle-ci ne reviendront dans la vie publique qu’en 1955, grâce à la dictature militaire anti-péroniste. Discrédités, ils se fragmentent et n’existent plus que localement ou à l’état groupusculaire.
La politique sociale innovatrice et musclée de Perón a éliminé la gauche de la vie politique argentine. Elle n’y est pas revenue. En ce sens, il a accaparé la gauche sociale et anéanti la gauche politique
Vous écrivez (p.181) que la répression de la junte argentine, moins visible que celle de Pinochet au Chili, fut cependant beaucoup plus féroce. Pouvez-vous développer ?
Les chiffres issus de diverses commissions ad hoc dans les deux pays, montrent que le nombre des victimes, par rapport à la population, semble avoir été plus élevé en Argentine. Mais les statistiques de l’horreur ne révèlent pas tout. Il faut y ajouter les modalités répressives, sans doute plus révélatrices encore. La dictature argentine a pratiqué systématiquement la disparition forcée des personnes, les représailles familiales et les vols d’enfants, autant de modalités génocidaires d’éradication de l’ennemi.
En Argentine, l’État terroriste s’est donné les moyens de son efficacité maximale. La répression (au moins entre 1976 et 1980) est décentralisée, compartimentée en droit comme en fait. Les chefs de corps ont droit de vie et de mort dans leur zone d’opération. Tandis que les rivalités entre les trois forces armées (terre, air, mer) entrainent les surenchères et l’arbitraire généralisé, aucun organisme, comme la DINA (Direction nationale du renseignement) au Chili, ne centralise ni n’enregistre les opérations. Pour plus d’efficacité l’action antisubversive se fait de manière anonyme. Des commandos paramilitaires exécutent ou enlèvent les opposants supposés. Les suspects ne sont pas arrêtés mais ils disparaissent et sont regroupés dans 380 centres clandestins de détention. Ce sont autant de réserves d’otages qui alimentent les représailles massives. Cette machine à tuer furtive a fonctionné plusieurs années après le coup d’État alors qu’officiellement toutes les guérillas avaient été anéanties.