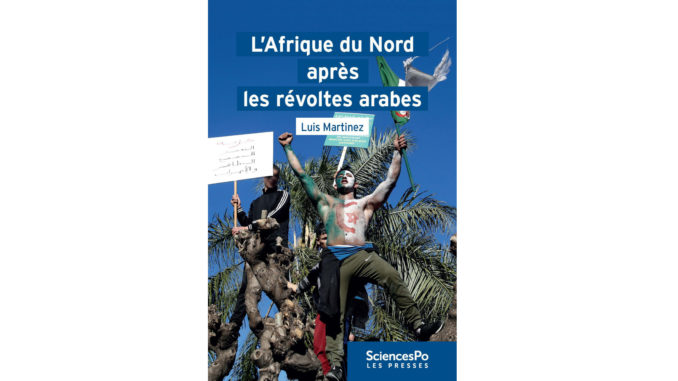
Directeur de recherche au CERI (SciencesPo) en tant que spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, Luis Martinez répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « L’Afrique du Nord après les révoltes arabes » aux éditions Presses de Sciences Po.
Selon vous, le choix de la démocratie qui s’efface au profit de régimes autoritaires – seuls capables d’assurer le développement – date des années 1960…
Le choix de la démocratie s’efface en Afrique du Nord au profit de la volonté de sauvegarder la cohésion nationale. La démocratie fait peur, elle apparait comme un danger menaçant les États indépendants. Historiquement, les nations d’Afriques du Nord ont trouvé dans la contestation de l’oppression coloniale les liens qui les unissent : dans les États post coloniaux, quels sont les liens qui unissent encore les individus, les groupes et les communautés ? Qu’est-ce qui fait « tenir ensemble » ces jeunes États-nations ? Au lendemain des indépendances, les régimes autoritaires promettent le développement, la cohésion nationale, « l’État fort » mais non la liberté d’expression, d’associations et de représentations. Pour les élites nationalistes, le peuple est « immature » et la société civile « sous développée ». Reprenant les représentations véhiculées sous le régime colonial, les nouveaux dirigeants ont la volonté de « rééduquer » le peuple, de le « civiliser » afin de l’adapter à l’ère post coloniale.
Le design autoritaire des États en Afrique du Nord a trouvé ses limites dans les révoltes de 2010. Les revendications pour une meilleure gouvernance, pour plus de justice et de solidarité ont déstabilisé des autorités qui n’avaient pas anticipé ces mobilisations citoyennes. Ce surgissement de l’imprévu contraint les États à de profondes transformations afin de garantir l’unité nationale : la décentralisation à l’œuvre au Maroc et en Tunisie vise à rapprocher l’État des besoins de ses citoyens ; les revendications pour un État fédéral en Libye soulignent l’impératif de respecter des territoires et des pouvoirs locaux désabusés par le passé autoritaire du régime de Kadhafi. Effectivement, les revendications démocratiques participent à la volonté des populations de voir des institutions politiques à même de représenter et surtout de contrôler les dépenses de l’État. Le gaspillage et la corruption sont dénoncés depuis des décennies sans qu’on puisse pour autant percevoir des améliorations. Les révoltes arabes interpellent la trajectoire des États ; elles rappellent la nécessité de leur transformation dans la perspective de servir l’intérêt général. A défaut, toutes les forces politiques, régionales et idéologiques qui ambitionnent de détruire l’État-nation hérité de la colonisation trouveront dans la faiblesse des États les arguments mobilisateurs pour le déconstruire.
Comment expliquer l’exception tunisienne ?
Exception, anomalie, la transition tunisienne interpelle car elle est pour l’instant la seule à déboucher sur un processus démocratique. « Le printemps arabe » a commencé en Tunisie et force est de constater que ce pays constitue le dernier et mince espoir dans la région. Embarqués dans une traversée qu’ils n’ont pas préparée, militaires, islamistes du parti EnNahda, défenseurs des droits humains, radicaux de tout bord, jeunes diplômés ou pas, chômeurs, tous apprennent, non sans mal, à naviguer ensemble vers un cap inconnu. La peur de chavirer et de rejoindre les exemples malheureux de pays en guerre civile rend sans doute les Tunisiens plus raisonnables et disposés à accepter des compromis. Parmi les facteurs explicatifs du succès de la révolution tunisienne, celui du rôle de l’armée en janvier 2011 est crucial et trop souvent négligé dans les analyses sur la transition tunisienne. En effet, le 13 janvier 2011, le Général Rashid Ammar, chef d’État-major des Forces armées tunisiennes, refuse de donner l’ordre d’ouvrir le feu contre les manifestants. Héros pour les manifestants, traitre pour les anciens du régime de Ben Ali, le refus de rejoindre la police dans la répression des manifestants fait vaciller le régime. Cet acte de désobéissance au pouvoir politique affaiblit le président Ben Ali qui fuit le pays, deux jours plus tard, pour l’Arabie Saoudite. Le 24 janvier 2011, alors que des manifestants réclament la démission du gouvernement de transition composé de caciques du régime de Ben Ali, le général Rashid Ammar improvise un discours sur l’esplanade de la Kasbah : « L’armée nationale se porte garante de la révolution. L’armée a protégé et protège le peuple et le pays… Nous sommes fidèles à la Constitution du pays. Nous protégeons la Constitution. Nous ne sortirons pas de ce cadre ». À la différence de l’Algérie, l’armée est sous le contrôle du pouvoir politique. Les partis politiques, toutes tendances confondues, ont réussi à produire un compromis constitutionnel. Sans doute est-ce là le résultat de la synthèse entre l’héritage de Bourguiba (constitution et éducation) et la lucidité des acteurs politiques. Il reste que la dégradation des conditions socio-économiques menace la démocratie tunisienne.
Pour vous, l’opération Serval est une erreur qui a profité aux djihadistes, pourquoi ?
Pourquoi la France est-elle intervenue ? Seule ? Quelles sont les raisons qui expliquent une telle opération aux conséquences incalculables ? Est-ce pour réparer les conséquences désastreuses de son intervention dans le cadre de l’OTAN en Libye ? Force est de constater que la France est enlisée au Sahel alors que les groupes djihadistes étendent leur influence bien au-delà du Sahel aujourd’hui. L’intervention française au Nord du Mali réactualise la figure de « l’envahisseur français », propagée tout au long de la colonisation. A cela s’ajoute, non sans un retournement de l’histoire, l’Algérie devenue, pour les djihadistes, un pays allié de la France. Quasi inexistants il y a quinze ans, les groupes djihadistes déstabilisent les États par leur stratégie de violence et terrorisent des communautés qui se sentent abandonnées. Après l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, le reste du continent africain émerge comme une zone d’expansion pour ces groupes qui mesurent les opportunités qu’offrent ces régions. À la différence des pays arabes, les armées des États de l’Afrique subsaharienne sont faibles et demeurent dans l’incapacité de résister à leur guerre d’usure sans un soutien international, et cela en raison de l’immensité des territoires. La légitimité des États est profondément remise en question dans des territoires où la présence de l’État est vécue comme une agression. De plus, la démographie offre un vivier inépuisable de combattants. Enfin, la présence des ex-puissances coloniales permet de construire la figure de l’ennemi qui pille et maintien au pouvoir des dirigeants davantage préoccupés par leurs richesses personnelles que par l’intérêt général. Pour les groupes djihadistes, l’Afrique subsaharienne est un terreau éminemment favorable, tant la porosité des frontières permet, sans encombre, de mener des activités criminelles. En fait, la facilité avec laquelle les djihadistes se déploient depuis le renversement de Kadhafi, illustre l’intégration de ces groupes dans les communautés (Touaregs, Peuls, Kanouri etc.) de la région. À la faveur des révolutions arabes, les groupes djihadistes prennent leur revanche : l’implosion de la Libye, le renversement du régime policier de la Tunisie, la chute de Blaise Compaoré au Burkina Faso, leur offrent un champ des possibles inattendu. Les groupes djihadistes locaux nouent de nouvelles alliances et favorisent l’installation de Daech dans la région. Un foisonnement de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à Daech se déploient du Sahara algérien à l’Afrique de l’ouest. Ils ambitionnent de détruire les États-nations issus de la colonisation et de restaurer le califat. Après l’Opération Serval, l’Opération Barkhane installe les troupes françaises dans un dispositif permettant une lutte incessante contre les groupes djihadistes. Pour ces derniers l’intervention de la France au Sahel est une aubaine, elle permet de structurer le djihad autour d’un objectif tangible, accessible, visible : le départ de la France. L’objectif de chasser la France et les Français de la région est déclaré. Après les nationalistes des années 1950 et 1960, ce sont les djihadistes qui projettent de chasser les anciens « colons » qualifiés aujourd’hui d’« infidèles » ou d’« envahisseurs ». Après les pays du G5 (Tchad, Niger, Mali, Mauritanie, Burkina Faso), l’Algérie, le Maroc, l’Égypte prennent la mesure que plus la France s’enlisera, plus ils deviendront indispensables.
Cet article est également disponible sur MédiapartLeClub.
