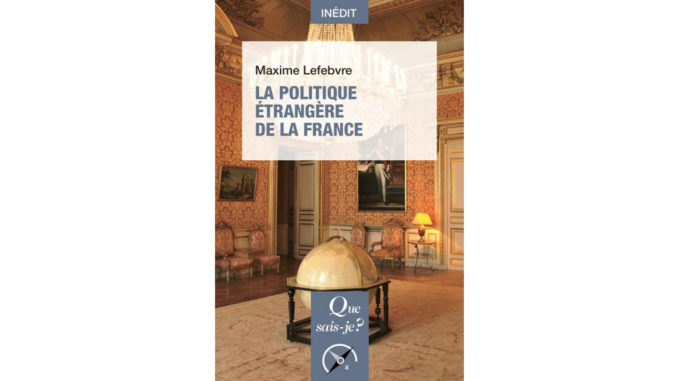
Diplomate de carrière, ancien ambassadeur auprès de l’OSCE, Maxime Lefebvre est professeur affilié à l’ESCP Europe. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son Que-sais-je ? « La politique étrangère de la France » aux éditions puf.
Le rôle du président de la République est-il l’axe central de la politique étrangère française ?
Oui. Le président de la République exerce un triple rôle de représentation, d’orientation stratégique et de gestion directe de certains dossiers européens ou internationaux. La Constitution de la Ve République, voulue par le général de Gaulle, lui donne des pouvoirs considérables hérités de la tradition monarchique : c’est sous son autorité que sont négociés et ratifiés les accords internationaux, il est le chef des armées et donc le décideur suprême des interventions militaires, il nomme les ambassadeurs et directeurs (en Conseil des ministres).
La présidence d’Emmanuel Macron en donne plusieurs illustrations: c’est lui qui est à la manœuvre dans les nominations aux plus hauts postes européens, c’est lui qui a voulu un nouveau traité franco-allemand, c’est lui qui s’implique directement dans la crise iranienne et qui veut réunir un nouveau sommet en format Normandie sur l’Ukraine, c’est lui qui a décidé de poursuivre les opérations militaires au Sahel ou de lancer des frappes contre la Syrie après l’emploi allégué d’armes chimiques.
Peu d’autres pays donnent un rôle comparable au chef de l’État. La plupart de nos partenaires connaissent une dyarchie chef de l’État / chef du gouvernement en confiant au second les pouvoirs diplomatiques et militaires (par exemple pour siéger au Conseil européen). Même aux États-Unis, le président doit savoir manœuvrer avec un Congrès aux pouvoirs importants pour la ratification des traités, les nominations, l’emploi de la force armée, le vote des budgets.
Cela ne veut pas dire que le Président exerce le pouvoir seul : les ministres, les conseillers, les militaires, les diplomates, les parlementaires parfois, jouent un rôle dans la décision. Et moins les affaires ont un caractère politique et stratégique, moins elles remontent à
l’Élysée et plus elles sont gérées par l’administration.
La réduction des moyens du quai d’Orsay n’est-elle pas dangereuse pour le rayonnement de notre diplomatie ?
Si. Le quai d’Orsay est soumis comme toutes les administrations publiques à la rigueur dans un État surendetté et aux disciplines budgétaires liées au pacte fondateur de la monnaie unique. Les indemnités à l’étranger ont été réduites, les salaires n’augmentent plus. Le ministère a réduit considérablement ses effectifs, passant de 20.000 agents en 1998, maximum atteint après la fusion avec le ministère de la Coopération, à 13.000 aujourd’hui. Il a fermé nombre d’ambassades, de consulats, d’instituts culturels. Il a réussi à sauver de justesse le principe de “l’universalité du réseau” : la France a encore le 2e réseau diplomatique mondial, mais beaucoup de postes ont été réduits et sont appelés pudiquement “postes à présence diplomatique”, et il y a quand même 30 pays où la France n’a pas d’ambassade.
Le patrimoine immobilier à l’étranger, héritage d’un passé diplomatique glorieux et prestigieux, est peu à peu cédé pour financer des dépenses de fonctionnement. Sans doute est-il nécessaire que l’État réduise son train de vie : notre représentant aux Nations unies devait-il vivre dans un 700 m2 au coeur de Manhattan ? Mais à chaque fois qu’on ferme une implantation, qu’on se sépare d’un bâtiment emblématique de la présence française, c’est le pavillon français qu’on abaisse un peu plus.
Il faut réaliser que la diplomatie fait partie du cœur des pouvoirs régaliens : c’est un des quatre plus anciens ministères de l’État, avec l’Intérieur, les finances et la guerre, qui remontent à l’Ancien Régime. En effectifs, le ministère (administration centrale et ambassades confondus) pèse moins que la Commission européenne ou la mairie de Paris. On sent quotidiennement la contrainte dans les budgets de voyages, dans les contributions volontaires aux organisations internationales pour lesquelles beaucoup de partenaires européens plus petits nous surpassent. On est déjà à l’os et la politique du rabot ne pourra pas se poursuivre sans qu’on réduise dramatiquement les missions et l’influence de la France dans le monde. Plusieurs responsables, notamment Alain Juppé et Hubert Védrine, ont cherché à alerter l’opinion sur les risques d’une contrainte budgétaire à courte vue.
Est-il, ou non, exagéré de parler de la France comme d’une puissance d’influence mondiale ?
La France n’est pas une superpuissance comme les États-Unis ou la Chine. Elle est une puissance “moyenne”, mais c’est une catégorie qui compte. La revue Conflits a mis la France en 4ème position dans son indice composite de la puissance, juste derrière la Russie. Ce n’est pas
rien dans un monde qui comprend presque 200 pays. La France joue dans la même catégorie que l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon, l’Inde, l’Italie, le Brésil, et elle a plus d’atouts réunis que chacun de ces pays. Elle joue sur tous les claviers de la puissance : c’est une économie majeure, une puissance diplomatique, une puissance militaire, une puissance culturelle, un pays qui attire les investisseurs étrangers et les touristes. Elle est un acteur clé de la politique européenne. Elle pèse comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, comme puissance nucléaire, par ses possessions, ses bases, ses opérations outre-mer, comme locomotive de la francophonie.
La puissance de la France a décliné du fait de la prépondérance américaine, de la réunification allemande, de la montée des puissances émergentes. Mais elle a préservé de beaux restes, elle reste portée par son dynamisme démographique, par sa stabilité politique et le volontarisme de ses dirigeants, par ses valeurs qu’elle sait défendre avec fierté. Il lui faut corriger ses faiblesses dans le champ économique (le poids de la dépense publique, le retard de compétitivité) et surmonter le pessimisme et la déprime de ses propres citoyens. Pour paraphraser le général de Gaulle qui disait “c’est parce que nous ne sommes plus une grande puissance qu’il nous faut une grande politique” : c’est parce qu’il n’y a pas de positions acquises qu’il nous faut nous battre pour maintenir notre statut de puissance moyenne.
Cet entretien est également disponible sur MediapartLeClub.
