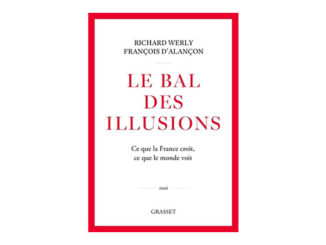Stéphane Gompertz, normalien et énarque, a été directeur Afrique au Quai d’Orsay et ambassadeur de France en Éthiopie et en Autriche. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Un diplomate mange et boit pour son pays », aux éditions O. Jacob.
Vous vous élevez contre les clichés en cours contre les diplomates. Comment expliquer leur persistance ?
Elle tient, je crois à trois raisons :
Tout d‘abord, les diplomates vivent souvent, c’est vrai, dans un cadre confortable, voire luxueux, surtout quand ils parviennent au sommet de la hiérarchie. Les ambassadeurs ont fréquemment – pas toujours – de belles résidences, ils disposent d’un chauffeur et d’une voiture de fonction. Les diplomates jouissent de l‘immunité. Elle est nécessaire pour les protéger dans leurs fonctions de représentation et de négociation. Mais les gens ont l’impression que les diplomates en profitent pour se soustraire aux règles communes. En règle générale, c’est faux. Il y a bien sûr quelques exceptions : j’ai connu des diplomates qui ne payaient pas leurs contraventions. La presse a relaté des cas de diplomates étrangers en poste à Paris qui maltraitaient ou ne payaient pas leur personnel. L’opinion s’indigne que le coupable ne puisse pas être mis en prison mais seulement expulsé : on peut la comprendre. Cependant, il s’agit de cas exceptionnels. Et la vie diplomatique peut parfois être austère, voire dangereuse, particulièrement avec la montée du terrorisme. Beaucoup de diplomates ne peuvent pas sortir de chez eux sans escorte policière ou militaire. Plusieurs de mes collègues ont été tués ou blessés dans des attentats. Nous sommes tous, un jour ou l’autre, confrontés à la violence. J’en ai fait l‘expérience à la morgue du Caire. Cela, les gens l’ignorent.
Ensuite, la diplomatie a souvent l’image d’un métier futile, où on passe son temps en parlotes et en réceptions. Le langage diplomatique, avec ses codes, paraît vain et artificiel. Les envoyés boivent du champagne et mangent des petits fours pendant qu’on s’étripe et qu’on meurt. Les discussions diplomatiques sont souvent longues. On n’a pas toujours la chance d’arriver à un accord, comme j’en ai fait la belle expérience aux côtés d’Hervé de Charette lors de la crise des Raisins de la colère. Alors, l’opinion s’impatiente et se demande à quoi on sert. Et ce d’autant plus que beaucoup de tractations demeurent secrètes. J’ai confidentiellement, avec l’accord de mes autorités, négocié la libération d’une jeune femme au Proche Orient. Je l’ai rencontrée après sa délivrance : elle n’a jamais su, ni elle, ni les activistes qui manifestaient en sa faveur, comment les choses s‘étaient réellement passées.
Enfin certains politiques – pas tous heureusement – ont tendance à dauber sur les diplomates incapables de comprendre leurs géniales intuitions ou de les mettre en œuvre. Je n’ai pas rencontré tellement de responsables politiques capables de dire merci. D’une façon générale, il ne faut pas s’attendre à ce que le ministère vous témoigne de la reconnaissance. Mais celle de certains interlocuteurs extérieurs a tellement plus d’importance…
Comment apprendre l’art de la négociation ?
D’abord par l’apprentissage de certains préceptes de bon sens ; j’ai tenté d’en définir quelques-uns. Par exemple : se faire reconnaître comme interlocuteur ; respecter le partenaire ou l’adversaire, car l’arrogance est détestable et inefficace ; essayer de le comprendre et de déterminer ses objectifs et ses lignes rouges ; rechercher autant que possible un jeu à somme positive qui permette à chaque partie de repartir la tête haute, de sentir ou de donner l’impression à ses autorités et/ou à son opinion publique qu’elle a emporté des gains appréciables ; surtout ne pas lui faire perdre la face. Tenter de nouer avec les parties, sans perdre de vue ses propres objectifs, des relations humaines.
Ensuite et surtout, par la pratique, si possible en démarrant aux côtés de négociateurs expérimentés, habiles et humains. Pratiquer des interlocuteurs d’origines et de cultures différentes. Essayer de voir comment s’y prennent les négociateurs du privé. Et, comme partout, commettre des erreurs et s’en instruire.
Apprendre à garder un certain recul tout en s’engageant à fond. Même si les enjeux peuvent être dramatiques, la négociation est un jeu et on a intérêt à le prendre comme tel.
Vous insistez sur la nécessité pour un ambassadeur d’être en phase avec la société civile…
C’est essentiel. Un diplomate, quel que soit son rang –car il ne s’agit pas seulement des ambassadeurs– ne doit pas limiter ses contacts à ses interlocuteurs officiels. Connaître un pays, c’est connaître l‘ensemble de ses composantes, ses régions, ses divers milieux sociaux, ses corps de métier, ses générations. C’est tenter de pénétrer les façons de sentir, de vivre ou parfois de survivre, de voir et d‘exprimer le monde. Gilles Martinet, qui avait été un grand ambassadeur à Rome, avait écrit un livre vivant et pénétrant intitulé Les Italiens, où il décrivait des Italiens de tous les milieux, de l’aristocrate à l’ouvrier de chez Fiat. Cette tâche est loin d‘être facile mais elle est nécessaire. Nécessaire et passionnante. Les plus beaux contacts que j’ai noués, les plus belles amitiés, les plus durables, que je me suis constituées dans mes postes ont été avec des membres de la société civile. Quand j’ai participé à la préparation de la COP 21, j’ai été reçu par quatre chefs d’État et nombre de ministres. Mais la rencontre qui m’a le plus impressionné a été celle d’une marchande de Lomé qui avait fondé une association de prévention du SIDA et qui vendait des lampes solaires et des réchauds améliorés. Et quand on peut aider, parfois discrètement, les représentants de la société civile à faire avancer des projets, à secourir ou mobiliser les gens, comme en Ethiopie où j’ai beaucoup travaillé avec des associations de femmes, c’est formidable.
Cet entretien est également disponible sur Mediapart Le Club.