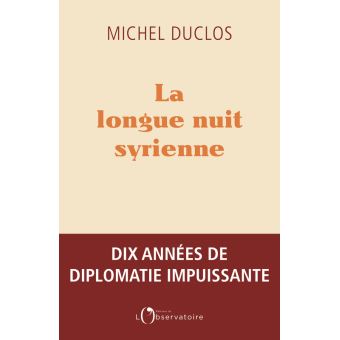
Ancien ambassadeur de France en Syrie et conseiller spécial à l’institut Montaigne, Michel Duclos répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « La longue nuit syrienne » aux éditions L’Observatoire.
Vous dressez un parallèle entre la guerre en Syrie et celle d’Espagne – comme défi pour nos démocraties – mais qui seraient Hitler et Mussolini ?
Je note en effet, en ouverture de « La longue nuit syrienne », que les démocraties se sont retrouvées devant un dilemme comparable dans l’Espagne de 1936-1939 et en Syrie à partir de 2011 : était-il opportun ou non d’intervenir dans ce qui pouvait s’analyser d’abord comme une guerre civile ?
Je n’insiste pas sur la métaphore historique dans mon livre car je sais que ce type de comparaison suscite toujours des contestations (et que de surcroit nos contemporains n’ont pas une très grande connaissance de la Guerre d’Espagne !). Puisque vous m’invitez à évoquer le parallèle, il me parait évident que la Russie de Poutine et l’Iran de Khamenei sont venus au secours du régime d’Assad comme l’Allemagne d’Hitler et l’Italie de Mussolini s’étaient engagés aux côtés de Franco. On peut d’ailleurs pousser plus loin le parallèle : ayant renoncé à aider le camp républicain, les démocraties de la fin des années trente avaient laissé le monopole du soutien de celui-ci à l’URSS, avec les conséquences que l’on sait (dévoiement et divisions du camp républicain) ; en Syrie, en mesurant leur soutien à l’opposition armée nationale, les démocraties laissaient le champ libre aux pays du Golfe pour pousser leurs propres clients (islamistes) dans la rébellion.
Le parallèle s’arrête toutefois avec l’émergence de Daech, qui n’a pas d’équivalent dans la Guerre d’Espagne. Il retrouve en revanche sa pertinence dans « l’après crise » : la Syrie a servi de cristallisateur à la montée en puissance des « néo-autoritaires » (de Poutine à Salvini en passant par Erdogan et quelques autres) comme l’Espagne avait été le banc d’essai de l’émergence des puissances totalitaires.
Quelles sont les particularités du régime syrien ?
On connait depuis des lustres les « fondamentaux » du régime syrien : derrière une façade « socialiste », un pouvoir minoritaire (les Alaouites), dominé par un clan, pratiquant une répression féroce, prêt à une violence sans limite, y compris la manipulation du terrorisme, mais bénéficiant d’une certaine indulgence internationale pour des raisons idéologiques (la « laïcité ») et géopolitiques (stabilité, etc…).
Lors de mon séjour à Damas (2006 à 2009), et sans remettre en cause les fondamentaux, j’ai observé toute une série de décalages entre l’image que l’on se fait du régime et les réalités. Par exemple, le parti Baath et l’armée, dans les années 2005-2010 avaient perdu beaucoup de leurs poids historiques ; ce qui constituait l’armature du système, c’était le pouvoir de la famille Assad s’appuyant sur les services de renseignements (Moukhabarat) et les affairistes lés à la famille. A partir de cette expérience, un certain nombre de présupposés courants sur la Syrie d’aujourd’hui me paraissent sonner faux : l’obsession qui était celle de l’administration Obama de préserver le parti Baath, en tirant les leçons du précédent irakien, ne correspondait pas aux équilibres de pouvoir internes au système syrien ; de même l’idée de garder Assad pour « maintenir les institutions de l’État » fait fi du fait qu’Assad, en matière d’institutions, ne croit qu’au noyau dur des Moukhabarat et de leur prolongement, le système carcéral – sous son contrôle personnel, cela va de soi ; il n’hésite pas à bombarder sauvagement les hôpitaux du pays ; autre exemple : croire que la « reconstruction » peut constituer un levier parait quelque peu naïf, quand on connait le désintérêt total du clan pour toute politique économique autre que l’enrichissement des proches de la famille.
Selon vous, en calculant au plus juste l’aide occidentale aux groupes d’opposition armée pour qu’elle ne tombe pas dans les mains des islamistes, on est parvenu au résultat inverse à celui recherché, pourquoi ?
Qu’il n’y ait pas de malentendu : je ne blâme pas la politique menée, car nul ne peut se mettre à la place des décideurs dans des situations aussi difficiles. Il faut simplement constater que ne recevant pas d’armes des Occidentaux en quantité suffisante (et en qualité appropriée), les rebelles se sont tournés vers les réseaux et les sources d’approvisionnements islamistes. Le grand tournant s’est produit en 2013 : cette année-là, l’intervention massive du Hezbollah au printemps, suivie de la non-intervention occidentale après les attaques chimiques dans la Ghoutta à l’été, ont eu pour effet cumulatif de convaincre une partie de plus en plus importante des rebelles que les djihadistes avaient raison, que l’on ne pouvait compter sur les Occidentaux : cela a été la chance de Daech et des autres centrales terroristes.
Vous évoquez un accord tacite entre la Russie, l’Iran mais aussi Israël pour maintenir Assad au pouvoir.
Oui, là aussi ce n’est pas une théorie, c’est un constat. Les Iraniens soutiennent Assad car ils ont conscience de leur impopularité en Syrie ; la famille Assad est à peu près leur seul point d’entrée, du moins jusqu’ici (ils essaient naturellement de diversifier leurs options). Les Russes ne veulent pas lâcher Assad en raison de sa valeur symbolique : il est la preuve vivante de leur capacité à mettre en échec la politique occidentale supposée de regime change ; et aussi parce que toute autre formule impliquerait pour eux de prendre des risques ou de s’exposer à des complications (cf : la question : « si ce n’est Assad, qui ? »). Enfin, les Israéliens ménagent les Russes, devenus leurs voisins et dont ils ont besoin ; ils pensent peut-être qu’à terme Assad basculera entièrement du coté russe et s’éloignera de ses tuteurs iraniens ; enfin, tout simplement, ils laissent courir sur son aire une politique pro-famille Assad qui jusqu’ici leur a garanti la paix aux frontières. Ils croient avoir affaire à un « démon qu’ils connaissent » sans se rendre compte que l’homme de Damas dépend désormais beaucoup plus des Iraniens que ce n’était le cas sous Hafez ou même lors des débuts de Bachar.
Cet entretien est également disponible sur Mediapart Le Club.

