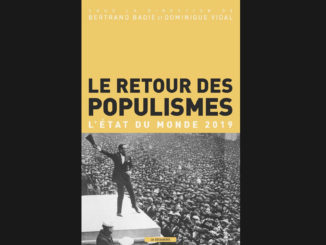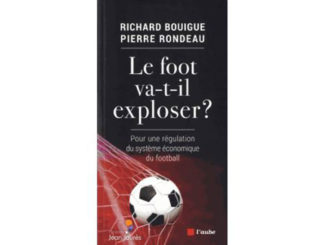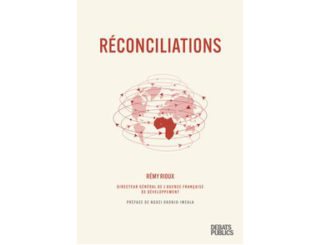Bertrand Badie est Professeur des universités à Sciences Po-Paris. Expert en relations internationales, il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Quand le Sud réinvente le monde : essai sur la puissance de la faiblesse », aux éditions La Découverte.
Pourquoi, selon vous, les mouvements de décolonisation – panafricanisme, panarabisme, etc.- visaient-ils plus à rassembler qu’à bâtir un État ?
On a trop simplifié l’analyse en considérant les mouvements de libération et leur leader comme porteurs de projets de construction d’États nouveaux. D’abord, dans la première moitié du XXe siècle, toutes les grandes conférences réunissant ces mouvements, ainsi que leurs manifestes, entendaient essentiellement dénoncer l’esclavagisme, l’impérialisme et le colonialisme. Leurs leaders s’affirmaient avant tout comme des libérateurs et retiraient leur charisme de cette identité plus ou moins accomplie. En outre, beaucoup d’entre eux, à l’instar de Kwame Nkrumah, tenaient la construction d’États-nations de format occidental comme un piège qui risquait de conduire à l’échec et à un nouvel asservissement. C’est pourquoi les doctrines du panafricanisme et du panarabisme furent si populaires et demeurent comme autant d’utopies mobilisatrices qui n’ont pas pu se réaliser, sources de frustrations et de déceptions. D’où probablement aussi le nombre impressionnant d’États faillis et d’États hyperautoritaires qui se sont développés à la suite de cette décolonisation manquée. Celle-ci n’a jamais eu ses « bâtisseurs d’États ».
Pensez-vous que la loi du plus fort conduit obligatoirement à la déroute ?
La puissance a perdu l’essentiel de son efficacité du fait de plusieurs facteurs. La décolonisation est historiquement le premier d’entre eux. Celle-ci a opposé à la puissance coloniale des fractions de la société soumise : or, le canon est efficace contre un autre canon, mais impuissant face à des mobilisations sociales. Aussi le plus faible a-t-il gagné à Diên Biên Phu ou en Algérie. Ensuite, les progrès de la mondialisation ont privé la puissance de son nerf d’origine. Dans un jeu mondialisé, l’interdépendance l’emporte sur la souveraineté et le fort devient souvent dépendant du faible, de ses échecs, de sa fragilité et de sa capacité de nuisance. Enfin, les nouveaux conflits internationaux sont d’une facture inédite qui ne les rend plus sensibles au jeu de puissance. Toute intervention de puissance se solde aujourd’hui par un constat d’échec.
La révolution de la communication n’a-t-elle lieu que dans les pays du Nord ?
Justement non. L’un des effets majeurs de la mondialisation se trouve dans la communication généralisée. On compte aujourd’hui plus de 300 millions de smartphones connectés en Afrique. La télévision s’y développe de manière remarquable. Même les populations les plus pauvres et les plus précaires disposent de certains moyens pour voir et connaître le monde dans sa globalité. Autrefois, le pauvre ne savait pas qu’il y avait des riches et le faible n’avait qu’une idée sommaire de la puissance : maintenant, tout le monde voit tout le monde, et notamment l’injustice. Aussi les imaginaires sociaux s’élargissent-ils, prenant en compte l’humanité tout entière. La mobilisation contre l’autre, riche, puissant et lointain se substitue à l’imaginaire local et à la résignation d’autrefois : voilà qui favorise fortement une réinvention du monde à partir du Sud, thème central de l’ouvrage.
Cet entretien est également disponible sur Mediapart Le Club.