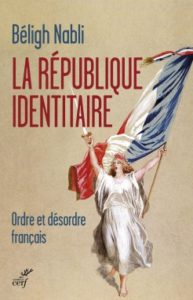Enseignant-chercheur en droit public, directeur de recherche à l’IRIS, Béligh Nabli enseigne les relations internationales à Sciences Po et a publié plusieurs essais sur l’exercice du pouvoir. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « La République identitaire » (Les Editions du Cerf), préfacé par Michel Wieviorka.
Vous estimez que la société française est plus multiculturelle que jamais mais demeure enserrée dans un ordre républicain qui se veut unitaire. Quelles en sont les conséquences ?
La République demeure de jure « une et indivisible », tandis que la société est de facto multiculturelle. Les deux assertions (l’une d’ordre juridique, l’autre de nature sociologique) sont-elles contradictoires ?
D’un côté, la société française est « objectivement multiculturelle », en ce qu’elle rassemble « en une unité politique des populations diverses par leurs origines, leurs croyances et leurs conditions sociales » (D. Schnapper). De l’autre, l’unité prescrite par notre propre tradition constitutionnelle vise la souveraineté de l’Etat et de son peuple (même si l’existence de « populations d’outre-mer » a été formellement reconnue). Or il n’y a pas ici forcément de contradiction entre les deux affirmations : certes il ne saurait exister de peuples particuliers au sein du peuple français, mais la République « une et indivisible » ne suppose pas une « identité une et indivisible », tant au niveau individuel que collectif. Les identités particulières peuvent se manifester (y compris dans l’espace public) et vivre ensemble … dans le respect d’un cadre commun défini par la Loi de la République.
La tension et les crispations naissent néanmoins de deux phénomènes. D’un côté, l’individualisation de la société s’accompagne de la manifestation publique d’appartenance à un groupe social, à l’attachement à des cultures spécifiques, à des identités singulières qui aboutissent à une demande de reconnaissance d’une mémoire, de droits voire d’intérêts particuliers. Légitimée par la doctrine multiculturaliste, cette tendance signifie également que les particularismes acceptent de moins en moins d’être relégués dans la sphère privée et alimentent une cristallisation communautaire qui s’exprime dans un espace public. De l’autre, le fait multiculturel ou la « multiculturalisation » de la France suscite un mouvement de réaction-rétractation. L’« identité nationale » s’est imposée comme norme de référence de l’ordre social et politique de la République. Et ce en dépit des approximations qui continuent de caractériser sa substance comme sa délimitation. Les tenants de « l’identité française » portent en eux une sorte de nationalisme ethnicisé, de souverainisme étriqué, un néo-conservatisme à la française en somme. Ce discours identitaire dominant frileux, nostalgique d’une France fantasmée, tente d’imposer une représentation de l’identité nationale réduite à l’identité majoritaire. Celle-ci est érigée en identité unique, supérieure, immuable, figée, réifiée, mais ni commune, ni inclusive. La menace nationale n’est plus symbolisée par le groupe social incarné par l’identité ouvrière, mais par cette communauté fantasmée constitutive d’une peur de l’identité musulmane d’autant plus forte qu’elle se rend visible. La suspicion pèse sur des musulmans présumés coupables d’anti-républicanisme et confinés à la fonction d’ennemi de l’intérieur.
Vous dénoncez les élus qui parlent d’une République unique mais qui localement jouent sur toutes les gammes du communautarisme. Pouvez-vous nous en dire plus ?
La tension entre une « République une » et une « société plurielle » est nourrie par les discours contradictoires et ambivalents de responsables politiques condamnant le communautarisme – les communautés étant perçues comme une menace pour la communauté nationale – pour mieux le pratiquer.
En effet, au-delà des postures dites républicaines, universalistes et donc indifférenciées, la classe politique n’hésite pas à se référer à des « communautés » supposées, figées artificiellement dans leur différence, en « essentialisant » leur identité collective, réelle ou imaginée. Avant d’être considérés comme citoyens et membres de la communauté nationale, les individus sont de plus en plus perçus à travers un regard racialisé, occupé de spécificités ethno-culturelles, desquelles on déduit l’appartenance à une communauté. Pis, la condamnation officielle de tout vote communautaire s’accompagne pourtant de pratiques clientélistes en direction de groupes sociaux considérés comme constitutifs de ces communautés. Les exemples abondent et nul parti ne semble échapper à cette contradiction, pas même le Front national qui a développé un discours directement destiné à la communauté dite des « harkis » tout en fustigeant le communautarisme…
Cela vous semble d’autant plus contestable que très souvent les représentants désignés ne représentent pas grand monde…
Paradoxalement, nos institutions démocratiques dites « représentatives » (l’Assemblée nationale, le Sénat) souffrent d’un déficit criant de représentativité politique et sociologique. L’archétype de l’élu du peuple ne correspond pas à sa diversité politique et sociale. La méritocratie élective est encore réservée à une fraction de citoyens, une « élite élue », une « représentation nationale » dont le caractère homogène et monolithique nourrit la crise de confiance qui caractérise la relation actuelle entre gouvernants et gouvernés.
Les élus se recrutent dans une frange particulièrement restreinte de la communauté nationale. La démocratie représentative a substitué à l’aristocratie une oligarchie élue dont la sélection des membres dénote une inégalité réelle. Cette réalité est le produit d’un mécanisme implacable : avant l’élection au suffrage universel, il y a une (pré-)sélection (l’investiture) exercée par les partis d’où résulte directement une sous-représentation politique des ouvriers et employés, des minorités « visibles », des femmes et des jeunes. La ségrégation sociale et territoriale se double d’une ségrégation politique. Le fait d’être visiblement issu d’un segment particulier de la société semble être une source d’illégitimité ou d’incapacité à incarner la représentation nationale. Si la « démocratisation de la démocratie » est nécessaire, il ne faut pas céder non plus au piège d’une représentation politique « miroir » d’une société fragmentée en diverses communautés…
Que faire pour relancer la machine républicaine à produire l’identification à la communauté nationale ?
La crise identitaire de la République est une crise de l’égalité. Les inégalités (sociales et territoriales) continuent de structurer une société incapable de conjuguer le respect du singulier et la définition du commun. L’atomisation et le cloisonnement de la communauté nationale ont engendré une citoyenneté à plusieurs vitesses dont l’inégalité sociale – plus que l’hétérogénéité culturelle des populations – demeure la matrice. En cela, la déconstruction de la république n’a rien d’un spectre, c’est une réalité. L’école se trouve ici au cœur de la chaîne des responsabilités. Pilier du « modèle républicain » – qui reste à (re)définir -, l’école n’échappe pas aux phénomènes discriminatoires. Notre système d’éducation s’est transformé en une machine de sélection et d’immobilité sociales, et contribue in fine à l’autoreproduction des élites. L’idée même de méritocratie républicaine se trouve altérée par des mécanismes de reproduction qui pèsent lourdement sur notre ordre social. Or, force est de reconnaître que les politique de lutte contre les inégalités et les discriminations sont loin de s’imposer dans l’agenda politique des « partis de gouvernement ». Pis, les questions sécuritaire et identitaire tendent à s’y substituer. Cette inversion des priorités est une forme de dévoiement de l’idée républicaine.