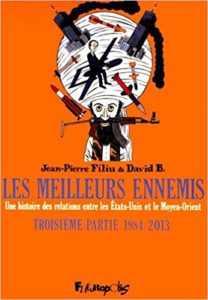Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po, et David B., auteur de bandes dessinées, se sont associés pour mettre en images l’histoire des relations entre les États-Unis et les pays du Moyen-Orient. Ils répondent à mes questions à l’occasion de la parution du troisième tome de leurs « Meilleurs ennemis » (1984 à 2013) aux Éditions Futuropolis.
Peut-on réellement expliquer les relations internationales en bandes dessinées ?
JPF : Le propos de David B. et de moi-même est moins d’expliquer que de produire un récit agréable à lire en bande dessinée. La séquence de trois décennies qui couvre ce troisième et dernier tome est d’une extrême densité événementielle. Nous en avons retenu quatre séquences correspondant aux quatre locataires successifs de la Maison blanche : George H. Bush et la libération du Koweït en 1991 ; Bill Clinton et les bombardements de 1998 contre l’Afghanistan, le Soudan, puis l’Irak ; George W. Bush et l’invasion de l’Irak en 2003 ; enfin, le refus de Barack Obama d’intervenir en Syrie en 2013. L’historien que je suis peut garantir que l’ensemble des dialogues figurant en bulles correspond à des propos effectivement tenus. Mais c’est l’artiste qu’est David B. qui donne le tempo du récit par un montage à mon sens extraordinaire de ces crises diverses. Son talent pour la métaphore graphique ne cesse de m’impressionner, comme par exemple le turban de l’Orient qui engloutit l’Amérique sur chacune des couvertures des trois tomes : les pirates « barbaresques » pour le tome 1, Khomeiny pour le tome 2 et Ben Laden pour le tome 3.
Vous estimez que le bombardement américain d’août 1998 a empêché les talibans de neutraliser Ben Laden, ce qu’ils auraient pu faire à l’époque. Pouvez-vous développer ?
JPF : Rappelons le contexte. Ben Laden anime les réseaux d’Al-Qaida depuis le Soudan, de 1991 à 1996, et le régime de Khartoum offre aux États-Unis de lui livrer cet hôte de plus en plus encombrant, comme ils ont livré Carlos à la France. L’administration Clinton refuse, car elle ne mesure pas encore la menace inédite que représente Al-Qaida. Ben Laden, expulsé de Khartoum, s’installe en Afghanistan, où son parrain local est éliminé par une nouvelle force, en expansion fulgurante : les Talibans du mollah Omar. Ben Laden, à la merci d’Omar, va l’amadouer en flattant ses prétentions à devenir « commandeur des croyants ». Mais Al-Qaida reste très vulnérable face aux Talibans, alors que les États-Unis demeurent passifs durant deux longues années, et ce malgré les déclarations de jihad anti-américain émises publiquement par Ben Laden. Après les attentats d’Al-Qaida, en août 1998, contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, les États-Unis auraient encore pu exiger des Talibans que Ben Laden leur soit livré. Ils ont préféré bombarder l’Afghanistan aux missiles de croisière : Ben Laden sort indemne de l’épreuve, ce qui accentue son aura médiatique, tandis que le mollah Omar tempête contre l’agression « infidèle » et lie désormais son sort à celui d’Al-Qaida.
Pourquoi, selon vous, Barack Obama a-t-il marqué la fin d’une période historique de l’Amérique au Moyen-Orient ?
JPF : Pour de bonnes ou de très mauvaises raisons, l’Amérique n’a cessé de se définir et de construire dans sa relation au Moyen-Orient. Comme David B. et moi le racontons dès le tome 1, la première guerre des tout jeunes États-Unis est menée dès 1801-1805 dans l’actuelle Libye. Et déjà deux présidents américains, Jefferson et Adams, opposent leur vision de « faucon » ou de « colombe » d’une Amérique engagée ou non au Moyen-Orient. On peut suivre ce fil rouge durant deux siècles entre les États-Unis et le Moyen-Orient jusqu’à aujourd’hui. Mais Barack Obama clôt en effet ce cycle en refusant, en août 2013, de faire respecter les « lignes rouges » qu’il a lui-même édictées en Syrie, quant à l’utilisation des armes chimiques. Après le bombardement par le régime Assad, entre autres au gaz sarin, de banlieues de Damas, Obama décide de ne rien faire. Cette reculade, loin d’apaiser le conflit en Syrie, a ouvert la voie à toutes les escalades, avec l’envolée des « montées au jihad » au profit de Daech et l’intervention croissante, et désormais directe, de la Russie. Obama, loin d’en tirer la moindre autocritique, a théorisé cette reculade pour en tirer une « doctrine » de politique étrangère. Mais il n’est plus ni « faucon », ni « colombe », il a juste admis, lui l’homme le plus puissant du monde, que sa parole au Moyen-Orient ne valait rien. Le saut dans l’inconnu et le réveil des monstres sont intervenus à ce moment précis, plus de trois ans avant l’élection de Donald Trump.