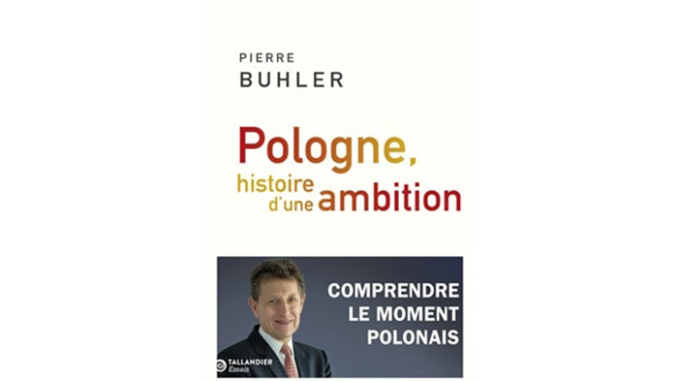
Diplômé d’HEC et de Sciences Po Paris, diplomate de carrière, Pierre Buhler enseigne désormais les relations internationales. A l’occasion de la parution de son ouvrage Pologne, histoire d’une ambition aux Éditions Tallandier, il répond à mes questions.
La Pologne est à la fois européenne et atlantiste. Donald Trump ne va-t-il pas l’obliger à faire un choix ?
Alors que la formation national-populiste Droit et Justice (PiS) n’avait d’yeux que pour Washington et avait des relations contentieuses tant avec Bruxelles qu’avec nombre de partenaires européens, l’arrivée aux affaires de Donald Tusk, fin 2023, a été l’occasion d’un aggiornamento. « Plus jamais de faiblesse, plus jamais de solitude », a-t-il déclaré en août 2024, pour résumer une politique de réarmement massif – lancée par le PiS et poursuivie par son gouvernement – et une stratégie de partenariats de sécurité tous azimuts : l’OTAN, l’UE, le Royaume Uni, l’Europe du nord et baltique, sans négliger la relation bilatérale avec les Etats-Unis. Ceux-ci déploient un dispositif militaire de quelque 10 000 hommes en Pologne, sur une dizaine de sites dans le pays, dont la coordination est assurée par une base permanente, baptisée « Camp Kościuszko », dans la région de Poznan. Le président en exercice, Andrzej Duda, qui a rencontré Donald Trump en février, a déclaré avoir reçu des assurances quant au maintien des troupes américaines . Le Premier ministre Tusk reste également attaché à la ligne constante de son gouvernement, déclarant qu’« il ne peut y avoir de place pour une alternative – l’Union européenne ou les États-Unis ».
Le modèle de réconciliation franco-allemand est-il exportable aux relations entre la Russie et la Pologne ?
Ce modèle s’appliquait à deux pays partageant un même attachement aux principes de la démocratie libérale, au respect de l’Etat de droit et des libertés civiques. On ne peut en dire autant de la Russie de Poutine. La Pologne a tenté de renouer un dialogue avec la Russie, à l’époque du président social-démocrate Kwasniewski (1995-2005), ancien ministre du régime de Jaruzelski, et à nouveau lorsque Donald Tusk dirigeait le gouvernement (2007-2014), avec des groupes de travail consacrés aux « questions difficiles », notamment relatives à l’histoire. Ces tentatives ont tourné court après l’annexion par la Russie de la Crimée en 2014.
La Pologne a-t-elle vraiment les moyens de passer à 5 % de son PIB pour la défense ?
Elle en a la volonté, constamment nourrie par les développements de la situation dans son environnement régional, qu’il s’agisse de la poursuite de la guerre d’agression de la Russie en Ukraine ou des opérations de « guerre hybride » à partir de la Biélorussie (envoi de migrants à travers la frontière) ou en Mer baltique. Elle en a les moyens politiques, l’effort de défense faisant l’objet d’un large consensus au sein de la société polonaise. Elle en a les moyens budgétaires, son niveau de dette publique restant inférieur au seuil de 60 % du PIB. Et si son industrie d’armement reste encore relativement modeste, la Pologne a passé des commandes d’armement très conséquentes aux Etats-Unis et en Corée du Sud pour combler ses déficits capacitaires. Elle met en place un dispositif défensif ambitieux, le « bouclier est », face à sa frontière avec la Russie et la Biélorussie. Le ratio des dépenses de défense dans le PIB est, en 2025, de 4,7 %, plus près qu’aucun autre allié de l’OTAN du seuil de 5 %. Qui plus est, la moitié du budget de défense est dédiée à l’achat d’armement, très au-dessus, donc, du niveau de 20 % recommandé par l’OTAN. Les effectifs de personnels en uniforme dépassent 200 000 hommes et continueront à croître, faisant des forces armées polonaises la première armée conventionnelle de l’UE. Sans doute cette montée en puissance rapide posera-t-elle des difficultés de recrutement et de formation, mais il ne fait guère de doute que le volontarisme et l’esprit de défense permettront d’y remédier. Les conditions attachées à l’utilisation des armements américains peuvent se révéler problématiques, mais cette dimension n’est pas spécifique à la Pologne.
Vous écrivez que la Pologne est installée dans un environnement géopolitique plus favorable qui ne l’a jamais été depuis des siècles. Cela peut paraître contre-intuitif…
En effet, cela peut paraître contre-intuitif si le regard se porte sur la seule situation d’aujourd’hui. Un regard qui embrasse l’histoire longue de la Pologne renvoie une image différente. Entre la fin du XVIIe siècle et sa sortie du glacis soviétique, en 1989, le pays, affaibli par sa situation intérieure, a d’abord été ravagé par les Suédois, . Au XVIIIe siècle, la Pologne est devenue un protectorat de la Russie tsariste, avant d’être dépecée par celle-ci et deux autres puissances prédatrices, la Prusse et l’Autriche, pour disparaître pendant 123 années de la carte politique de l’Europe. Le retour à l’indépendance, après 1918, s’est opéré dans la douleur, avec six guerres livrées et plusieurs insurrections avant que les frontières soient stabilisées, en 1921. Mais la trêve aura duré moins de deux décennies, jusqu’à ce que la Pologne soit à nouveau partagée par le Pacte Hitler-Staline, prélude à une nouvelle disparition et à un martyre infligé par les deux régimes les plus sanguinaires du XXe siècle, puis à une occupation soviétique de près d’un demi-siècle.
Par contraste, la menace allemande a disparu. La Pologne est aujourd’hui prospère, intégrée dans l’UE, dans l’OTAN. Loin de sa solitude d’antan, elle agit de concert avec ses partenaires européens et alliés pour faire front face à la seule menace existentielle sur sa sécurité : celle qui émane de la Russie.
Cet article est également disponible sur le blog de Mediapart et sur le site de l’IRIS.
