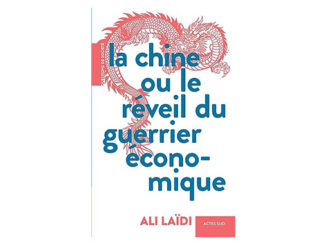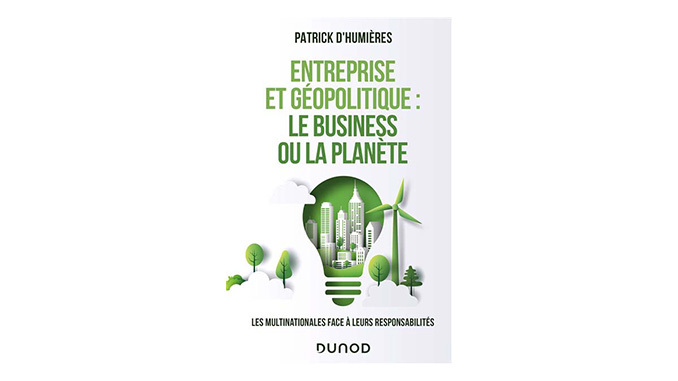
Spécialiste du management de la RSE et du développement durable en entreprise, co-fondateur d’Eco-Learn et enseignant à IRIS Sup’, Patrick d’Humières répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage Entreprises et géopolitique : le business ou la planète, aux éditions Dunod.
Comment définir une « économie responsable » ?
Jusqu’ici on a défini l’économie libérale à travers une double pratique de l’économie de marché, fondée sur un principe de liberté du commerce et de l’industrie, et de liberté des échanges favorisant la circulation des biens entre les pays. Ce système n’a jamais pris en charge ses impacts sur la biosphère, les ressources planétaires et les déséquilibres humains suscités, qu’on nomme externalités négatives, se contentant de croître pour croître au nom d’externalités positives, matérielles essentiellement. C’est ce système qui trouve sa limite physique déjà dénoncée en 1972 dans le rapport Meadows, Les limites à la croissance…
L’entrée de la Chine a l’OMC en 2001 a ajouté un grand acteur à ce jeu aveugle. Pékin se prétend aussi être une économie de marché, cachant son dumping social et environnemental derrière sa capacité à nous livrer tout ce qu’on veut au plus bas prix. Mais cette économie contemporaine n’est pas « responsable » car elle abandonne les externalités négatives, de plus en plus insupportables au fil du temps et de la démographie, au contribuable et plus souvent aux générations futures. Et ce, faute de règles sociales et environnementales qui corrigent en amont les modes de production et de consommation prédateurs de la planète, au regard de ressources limitées et d’inégalités croissantes.
Une « économie responsable » est un autre système qui repose sur un cadre contractuel entraînant les entreprises dans une prise en charge de leurs impacts sociaux et environnementaux, et s’appliquant d’une façon équitable à tous les partenaires commerciaux, dans le cadre d’une réciprocité et d’un contrôle effectif. On en est très loin, du fait de la paralysie de l’OMC qui ne joue pas son rôle en ce sens, et ce d’autant plus que les BRICS amplifient leur critique des contraintes sociales et environnementales imposées par les pays développés qui freinent leur développement.
Les États ont-ils perdu leur souveraineté face aux grands groupes ?
Les grandes entreprises occidentales sont les gagnantes toutes catégories de la mondialisation des dernières décennies. Elles ont acquis une prospérité, une résilience et une emprise (un market power) sur les marchés qui les dotent aussi d’une influence sociétale et géopolitique, surtout lorsqu’il s’agit des 100, voire des 1000 premières capitalisations du monde qui « font » les échanges, les innovations et la richesse de leurs actionnaires et salariés. Ces acteurs dominants sont devenus inexpugnables et sont la plupart du temps en position oligopolistique, du fait de l’affaiblissement de deux grandes politiques publiques : celle de la concurrence et celle de la fiscalité. Pour s’assurer l’investissement de ces groupes et rentrer dans la compétition avec les nouveaux géants chinois, incontrôlables, les États occidentaux ont lâché les freins. L’accord fiscal OCDE a descendu à 15% le taux de référence de l’impôt sur les sociétés et quant aux politiques anti-trust, elles sont vécues comme des atteintes à la souveraineté des pays. Bref, les États ont besoin, chez eux, d’un investissement dynamique et technologique que leur apportent les grands groupes, et à l’extérieur, de défendre une autre forme de puissance. Les États peuvent s’y retrouver lorsque les dirigeants ont des « relais » dans la place, pour contrôler des groupes multinationaux, mais c’est plus souvent un jeu de dupes car en économie libérale, les principes de responsabilité de l’OCDE sont purement déclaratifs et les groupes privés s’émancipent rapidement de leurs contraintes locales ; on rappellera qu’il n’existe pas de droit mondial des groupes mais seulement un droit commercial des sociétés sujettes aux règles locales uniquement !
Aujourd’hui, les solidarités États-Entreprises vont des formes lâches ou hypocrites caractéristiques des liens souples existant entre les États et le privé, aux modalités de contrôle caché ou nationalisé propres aux États autoritaires, qui font de l’économie une modalité de leur volonté d’affirmation.
La responsabilité climatique est-elle un critère d’acceptabilité des entreprises par l’opinion ?
Cette question est plus simple, pour deux raisons. Depuis l’Accord de Paris, un référentiel, volontaire, de la contribution des États à la baisse des émissions de carbone a été mis en place. La baisse des émissions doit alors passer par une mise en œuvre de la part des grandes entreprises émettrices, qui se retrouvent obligées à rendre des comptes. Cette « redevabilité » se précise et s’inscrit progressivement dans les comptes des investisseurs également. À cette transparence de plus en plus objective, et qui permet les comparaisons, s’ajoute une anxiété des opinions et un contrôle croissant du citoyen qui déplace ses choix en conséquence obligeant les entreprises à agir. Cette double pression conduit à un mouvement général qui associe décarbonation et business, dans un grand jeu de communication mal réglé (greenwashing). Progressivement, la sphère des clients exigeants s’élargit et rejette les offres irresponsables au profit des plus « sobres ».
Quel est le clivage entre les « entreprises engagées » et les « rentières » ?
Ce qu’on appelle les entreprises engagées sont celles qui se donnent des trajectoires de correction sérieuses, balisées, financées et assumées, pour changer leur offre et réduire leurs impacts négatifs, par opposition aux entreprises rentières qui profitent des trous de la régulation pour accumuler des bénéfices à travers des comportements prédateurs, tant qu’elles sont autorisées à le faire. Ce sont deux modèles qui n’ont pas les mêmes projets au regard du sens collectif, pas les mêmes rentabilités non plus et pas les mêmes relations avec leurs parties prenantes, solidaires dans un cas et indifférentes dans l’autre.
De COP en COP et de Sommets multilatéraux en accords de bonne volonté entre régions du monde qui veulent échanger leurs risques physiques contre des modes de vie plus sobres, nous dirigeons-nous vers un succès des entreprises engagées et un déclin des entreprises rentières, extractives ou technologiques ? Les entreprises se vouent-elles à optimiser simplement leur propre rendement, dans l’intérêt de leurs propriétaires, privés ou publics, ou acceptent-elles de se donner ou de se voir demander « une utilité sociale » objectivée qui les modère ? Telles sont les grandes interrogations sur la régulation économique multilatérale, aujourd’hui très limitée mais qui resurgira avec les crises programmées…
Cet entretien est aussi disponible sur MediapartLeClub et sur le site de l’IRIS.