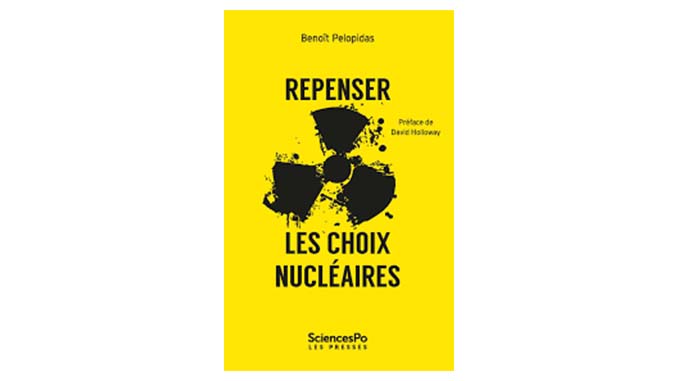
Benoît Pelopidas est fondateur du programme d’étude des savoirs nucléaires de Sciences Po (anciennement chaire d’excellence en études de sécurité au CERI) et chercheur associé à l’Université Stanford (CISAC). Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Repenser les choix nucléaires » aux Presses de Sciences Po.
Selon vous, ce que vous appelez le « paradigme de la prolifération » vient occulter les stratégies de sécurité nationale qui ne s’appuient pas sur les armes nucléaires…
Le paradigme de la prolifération (horizontale) décrit une façon de penser le problème des armes nucléaires. J’utilise l’expression de paradigme parce que la communauté des experts de la prolifération aspire à une validité scientifique de ses affirmations, et que les postulats dont nous allons parler déterminent le cadre dans lequel la recherche se mène. Ce paradigme désigne à la fois l’énigme scientifique et le problème politique à résoudre. Il s’appuie sur trois postulats : la tendance principale de l’histoire nucléaire serait l’augmentation du nombre d’acteurs dotés d’armes nucléaires au fil du temps, les arsenaux existants seraient contrôlables, et les armes nucléaires a priori désirables.
En France, cette approche se retrouve dans les discours gouvernementaux, chez les experts et dans la presse. Je le documente en détail. Si la prolifération est inévitable, alors le désarmement est impossible. Et pour que le problème des armes nucléaires puisse se réduire à la prolifération, il faut croire en la contrôlabilité parfaite des armes existantes et en l’efficacité de la dissuasion nucléaire. Les tenants de ce paradigme écrivent donc comme si le désarmement et les explosions nucléaires non désirées étaient impossibles, et que les seules politiques possibles étaient des politiques de non-prolifération, de dissuasion nucléaire et de maîtrise des armements. L’ouvrage montre que les trois postulats dudit paradigme sont inexacts en passant en revue l’histoire globale de l’âge nucléaire à partir d’entretiens, d’archives et de la littérature sur le sujet en français et en anglais.
Manquerait-il un espace de chercheurs indépendants sur les questions nucléaires en France ?
Il est rare qu’un producteur de discours ne se proclame pas indépendant. Afin d’éviter les protestations stériles, je définis donc la recherche indépendante comme une série de pratiques vérifiables: la non-réappropriation des catégories du langage officiel comme catégories analytiques, une pleine conscience des effets d’autocensure liés à l’utilisation des catégories de la pensée nucléaire, le refus strict du conflit d’intérêts qui se traduit par un financement exclusif sur la base du mérite académique, et un travail interdisciplinaire, conceptuel et empirique, qui permet de poser en toute rigueur les questions que la supposée performativité du discours officiel empêche de poser. À partir de cette définition, oui, il manquait un espace de chercheurs indépendants sur les questions nucléaires en France. L’ouvrage détaille les pratiques contraires courantes. C’est pourquoi nous avons trop longtemps tenu pour vraies des affirmations fausses qui produisaient l’illusion d’une inévitabilité de notre politique nucléaire et de l’absence d’alternatives : l’inévitabilité de la prolifération, l’absence de rôle de la chance dans l’issue des crises nucléaires passées ou son caractère impossible à mesurer, l’existence d’un consensus en France quant à la politique française de dissuasion nucléaire ou celle d’un débat expert satisfaisant qui aurait informé le choix. Il aura suffi d’un refus strict de tout financement porteur de conflits d’intérêts, car issu d’acteurs défendant une politique nucléaire particulière – ministère des Armées, CEA, Industries ou militants antinucléaires – et d’une interdisciplinarité rigoureuse soumise aux standards internationaux de la recherche, pour découvrir que ces idées sont fausses. C’est en ce sens que je me permets de dire que cet espace manquait. Il faut donc développer une recherche académique rigoureuse et indépendante sur les phénomènes nucléaires.
Vous remettez en cause l’idée qu’il puisse y avoir un consensus sur la question de la dissuasion nucléaire en France…
Si l’on se pose la question au niveau des principaux partis politiques, la notion de consensus entendue comme absence de proposition alternative est pertinente. Mais l’idée que l’on entend fréquemment chez les experts et qu’on lit dans un rapport du Sénat de 2017 suggère qu’une telle approbation qualifie adéquatement les attitudes des Français vis-à-vis de la politique de dissuasion nucléaire. Dans une démocratie libérale, le consensus suppose que des citoyens soient en mesure de donner leur consentement à un choix politique sur la base de connaissances à tout le moins disponibles et d’alternatives clairement présentées. Aucun de ces critères n’est réuni. Dans l’ouvrage, je le montre à partir d’une analyse précise des fautes méthodologiques qui ont présidé à l’élaboration du sondage de la DICOD supposé établir l’existence du consensus. J’y ajoute deux sondages inédits de 2018 et 2019 sur un échantillon représentatif de la population, conduits à l’aide du même institut de sondage que celui de la DICOD (l’IFOP) puis d’un autre (Yougov) afin d’éviter tout biais lié au panel utilisé par un institut en particulier. Ces sondages produisent des résultats stables et incompatibles avec la thèse du consensus. Ils permettent de distinguer plusieurs attitudes possibles et mettent en lumière que, plutôt qu’un soutien, les politiques menées ont surtout généré une mise à distance de la population vis-à-vis des politiques liées aux armes nucléaires. Enfin, des données d’archives mettent à mal l’idée d’un consensus qui se serait érodé avec le temps. Je me permets de signaler au lecteur que les sondages inédits présentés dans l’ouvrage concernent également le Royaume-Uni, les 5 États hôtes d’armes nucléaires en Europe (Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Turquie), la Pologne et la Suède.
Cet entretien est également disponible sur MediapartLeClub.
