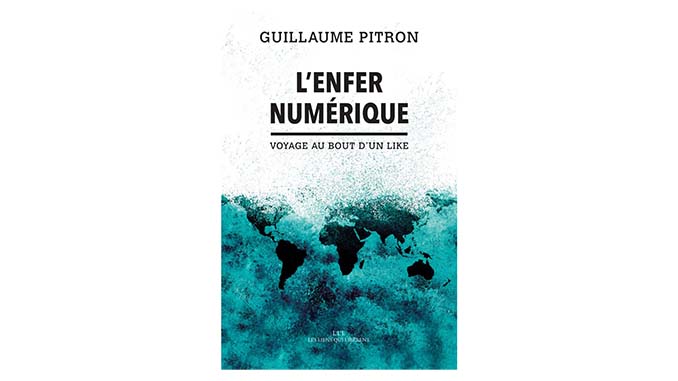
Guillaume Pitron est journaliste, documentariste et essayiste, spécialiste des matières premières et notamment des métaux rares qui servent à fabriquer les outils numériques. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « L’enfer numérique. Voyage au bout d’un like. » aux éditions Les liens qui libèrent.
Smart cities, voitures autonomes… Toutes ces innovations présentées comme permettant de diminuer la consommation d’énergies sont des leurres ?
Si leurre il y a, c’est parce qu’il existe une ambiguïté sur la soi-disant « immatérialité » de ces technologies. C’est une croyance notamment propagée par les pionniers du Web, à l’image de John Perry Barlow, qui a écrit en 1996 la Déclaration d’indépendance du cyberespace. Animés par un esprit libertarien, ils envisageaient le réseau comme détaché de la matière, et donc libéré des contraintes physiques – et politiques – cadenassant le monde réel.
S’ajoute marketing qui propage cette idée du cloud, du nuage. Il est entretenu par un imaginaire visuel qui nous induit en erreur, car le nuage se trouve en fait sur le sol, sous la forme de millions de hangars abritant des serveurs dans lesquels sont stockées nos données.
Et puis, il y a les designers de produits électroniques. Quand Steve Jobs conçoit l’esthétique de l’iPhone, il veut que cet outil soit à l’image d’un temple bouddhiste zen japonais, avec ses formes épurées. A sa suite, les Smartphones sont aujourd’hui des objets éthérés, qui nous induisent dans l’erreur d’un numérique propre. Leur simplicité d’utilisation, quant à elle, ne nous permet pas de percevoir la complexité de l’infrastructure qui permet de les connecter les uns aux autres.
Dans cet esprit, les Smart Cities et les véhicules connectés sont perçus comme alliés de l’environnement. La réalité est que ces outils sont fortement consommateurs de matériaux et d’énergie au point que l’on s’interroge, aujourd’hui, sur le gain écologique réel de l’ensemble des technologies numériques sur l’environnement.
Les data centers sont donc des hyper consommateurs d’énergie…
Les centres de données mobilisent à ce jour entre 1 et 3% de la consommation électrique mondiale. Ce chiffre va augmenter compte-tenu de l’explosion de la production de données permise par l’économie du gratuit et la surconsommation de services numériques qu’elle permet. En 2035, l’humanité produira probablement 2 172 zettaoctets de données par an, soit 45 fois plus qu’aujourd’hui. L’amélioration des techniques de stockage, l’optimisation de la consommation électrique des data centers suffiront-elles à limiter les impacts écologiques de cette industrie ? Nul ne sait.
Une chose est certaine en tout cas : pour un fonctionnement optimal des serveurs, ces centres de données doivent être refroidis. La moitié de l’électricité qu’ils consomment est mobilisée pour faire fonctionner les seuls systèmes de climatisation. Une solution consiste alors à déplacer la géographie du cloud vers le cercle arctique, où le froid est abondant, naturel et gratuit. Mais cela n’y suffira pas car les données, en vertu d’une logique de souveraineté de nos data, ont vocation à être relocalisées au plus proche de leurs utilisateurs, loin des pôles.
Faudra-t-il choisir entre l’accès aux technologies numériques et la préservation de la planète ?
Le cadre d’action proposé par les accords de Paris ne me paraît pas compatible avec la transition numérique telle qu’elle est actuellement entreprise. Je ne dis pas cela de gaité de cœur, mais cela me semble honnête de relever cette incohérence. Les technologies numériques n’ont jamais été déployées pour « sauver » le climat, mais pour faire prospérer le capitalisme « virtuel », proposer de nouveaux services et des nouvelles manières de consommer, bref… accroître des richesses. Le numérique permet aujourd’hui « la grande accélération », pour le meilleur – surtout en temps de pandémie où ces outils ont permis la résilience de nos économies et de conserver une vie sociale – mais avec d’inévitables impacts écologiques que nous avons de plus en plus de mal à contrôler.
Ne pas choisir entre technologies et écologie exigera de nous la sagesse d’allonger le nombre et la durée de vie des équipements, de nous interroger sur les dangers de la fausse gratuité du net qui nous pousse à sur-consommer du numérique, et même à questionner le principe de la neutralité du Web en priorisant les usages les plus utiles au bien commun.
Est-il encore temps de réagir et comment ?
Nous sommes responsables de ce phénomène et nous devons et pouvons agir. Comme je l’ai dit plus tôt, il faut agir en utilisant moins de terminaux et en les conservant le plus longtemps possible. Cela implique au préalable de prendre conscience des stratégies d’obsolescence programmée – obsolescence technique, logicielle, culturelle – qui nous poussent à consommer toujours davantage.
La question de la surconsommation des données se pose. Il nous faudrait des sites plus épurés générant moins de pop-up et de vidéos. L’initiative du World clean up day est intéressante et consiste, un jour par an, à suivre des tutoriels en nettoyant sa boîte de courriels et ses vieilles photos oubliées dans son iCloud. Les gains engrangés ne sont pas immenses face au puissant raz-de-marée de la production de données que nous concocte l’internet des objets, et même le futur intégralement connecté de l’Internet de tout. Mais c’est un passage nécessaire pour nous éduquer à cette pollution encore mal comprise et évaluée, par inodore et invisible.
C’est pourquoi je crois à l’écologie des sens : les GAFAM et les vendeurs de voitures électriques et connectées continueront de nous raconter n’importe quoi sur les technologies censément « propres » et « virtuelles » tant que nous n’aurons pas confronté nos sens à la prodigieuse matérialité de nos modes de vie, faîte de mines qu’il faut visiter et relocaliser chez nous, et de centres de données que nous devrions arpenter à chaque fois que nous changeons de téléphone mobile !
Cet article est également disponible sur MediapartLeClub.
