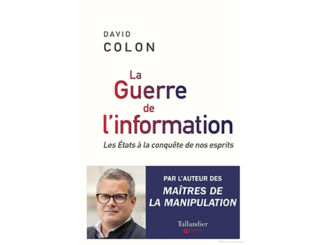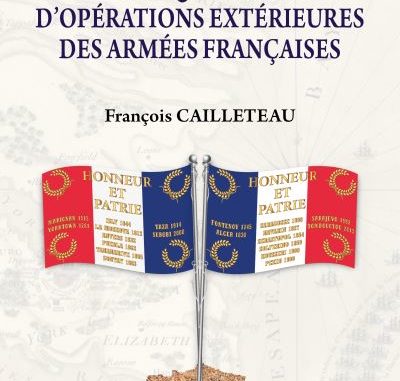
Ancien chef du Contrôle général des armées avant de rejoindre l’Inspection générale des finances, François Cailleteau répond à mes questions à l’occasion de la parution de son ouvrage « Cinq siècles d’opérations extérieures des armées françaises » aux éditions Economica.
Dans l’ensemble, et sous les différents régimes politiques, vous portez un jugement plutôt mitigé voire sévère sur les opérations extérieures. Médiocre pour l’Ancien Régime, abaissement définitif de la puissance française pour le Premier Empire, peu cohérent pour la Restauration, guerres pour le bénéfice d’autrui avec le Second Empire, manque de lucidité pour la IVème République face à la décolonisation…
Ce qui m’a paru en effet frappant lorsque l’on porte un regard sur la longue période, c’est le contraste entre la qualité presque toujours excellente des performances des troupes employées dans ces opérations et la médiocrité fréquente des décisions qui conduisent à initier ou à poursuivre leur engagement. On brade trois provinces françaises au profit des chimères italiennes, on travaille pour le roi de Prusse en négligeant de profiter des victoires du maréchal de Saxe en Belgique, on se lance dans l’immensité russe contre tous les avis et tout bon sens, on s’empare d’Alger sans avoir la moindre idée de ce que l’on va en faire, on sacrifie une centaine de milliers d’hommes en Crimée dans une affaire sans intérêt national, on ne sait pas partir à temps du Levant ou du Tonkin. La concentration des pouvoirs dans la main du souverain, la médiocrité du dialogue entre autorités politiques et chefs militaires, la difficulté d’admettre les nécessités du temps, l’indifférence de l’opinion, tout cela explique beaucoup des errements de notre politique d’engagement au-delà de nos frontières. Dans ce cadre, on peut retenir deux circonstances aggravantes. D’abord, quand le souverain est en même temps le chef militaire, les mécanismes nécessaires à l’élaboration de décisions raisonnées sont particulièrement fragilisés. On l’observe avec les rois de la Renaissance qui entreprennent les guerres d’Italie autant sinon plus en chevaliers qu’en souverains. Encore plus avec Napoléon dont l’autorité politique est renforcée par l’aura du général vainqueur : il peut dès lors sortir de toute rationalité stratégique sans que son entourage puisse le ramener au réel. Mais la faiblesse du pouvoir, sa soumission à des idées reçues ou à l’air du temps engendrent autant de risques. Ruiner ses finances et propager les idées démocratiques pour soutenir les colonies américaines contre l’Angleterre, laisser traîner les choses en Indochine au point d’avoir besoin d’une défaite éclatante pour pouvoir trancher, voilà le résultat fâcheux du délitement des institutions publiques.
En revanche, la IIIème République vous semble avoir un bilan plus positif, pourquoi ?
La IIIème République est née d’un double mouvement : la volonté d’une démocratisation des institutions dont le régime parlementaire est le pivot, et celle de surmonter le traumatisme de la défaite. Après quelques hésitations, elle s’engage résolument dans la conquête d’un empire colonial qui lui permettra de revenir à un statut de puissance mondiale. Elle cherche donc à s’emparer de tout ce qu’elle peut sur tous les continents. Mais avec deux modalités qui distinguent cette politique de celle de ses prédécesseurs. D’abord, elle veille à ce que la conquête coloniale ne la conduise jamais à un conflit armé contre une autre puissance. On le voit à Fachoda et encore plus dans le règlement de la dispute avec l’Allemagne dans l’affaire marocaine. Et puis, elle veille à transformer sa politique en une donnée de la conscience collective des Français. Les trois justifications énoncées dès le début par Jules Ferry (étendre la civilisation, conforter le rang de la France, améliorer son économie) deviennent un credo propagé par les institutions comme l’école et très généralement admis. Bien entendu, on peut contester la politique coloniale dans bien de ses aspects et même dans son principe. Mais force est de constater que les opérations extérieures de la IIIème République avaient une cohérence, qu’elles ont été réalisées sans gaspillage de moyens et sans nuire à la défense de la métropole.
On peut cependant juger que l’on est allé quelque peu au-delà des limites fixées à la politique d’expansion de la IIIème République après la Grande Guerre en voulant se tailler au Levant un morceau d’empire allant au-delà de nos forces (d’où les reculs face à la Turquie et aux difficultés à faire face en même temps à la guerre du Rif et à la révolte druze et damascène) tout en provoquant des frictions importantes avec notre principal allié, sans doute lui aussi trop gourmand.
Pour la Vème République, vous semblez plus partagé, pourquoi ?
La politique des opérations extérieures de la Vème République, après la décolonisation, est assez difficile à définir. La France n’est plus une puissance mondiale et elle n’a plus d’empire à conquérir ou à défendre. C’est donc une politique à bas bruit comme le montre la relative faiblesse des effectifs que l’on y engage mais aussi parce qu’elle est décidée par l’exécutif sans grande intervention du Parlement alors que l’opinion publique y porte peu d’attention sauf à l’occasion, heureusement rare, de pertes sensibles.
Et puis, les opérations sont de nature très hétérogène. Cela peut consister à défendre des pays alliés contre une agression extérieure (Mauritanie contre le Polisario, Tchad contre la Libye, Mali contre des mouvements djihadistes). Mais aussi intervenir dans des affaires intérieures (Gabon, Centrafrique, Côte d’Ivoire mais aussi Tchad). Il y a des participations à des expéditions américaines (Guerre du Golfe, Afghanistan, Somalie, Irak et Syrie) où notre rôle est second si la performance de nos contingents est souvent exemplaire. Autre modalité, la participation aux missions onusiennes où l’on n’a eu souvent le choix qu’entre l’inefficacité prolongée (Liban) et la prise en main de l’intervention par les puissances (Bosnie, Kossovo). Notons aussi deux affaires atypiques. Au Rwanda où l’on s’aventure sans justification sérieuse et où l’on persévère à intervenir après le génocide, certes pour des raisons humanitaires mais en prêtant le flanc à une accusation, infondée mais difficile à réfuter, de collusion avec les génocidaires. En Libye, où, au nom du devoir de protéger, on abat un régime certes peu sympathique au risque d’engendrer une guerre civile et une déstabilisation de la région qui nous forcera à intervenir dans le Sahel sans perspective de désengagement.
Il est donc difficile de trouver une ligne politique claire dans cette multitude d’engagements. Si ce n’est peut-être une idée qui se perpétue de montrer au monde une France qui pèse dans les affaires internationales. Cela exige le succès surtout dans les affaires où nous sommes les seuls ou les principaux intervenants. A cet égard, l’évolution de la situation au Sahel sera déterminante.
Cet entretien est également disponible sur Mediapart Le Club.