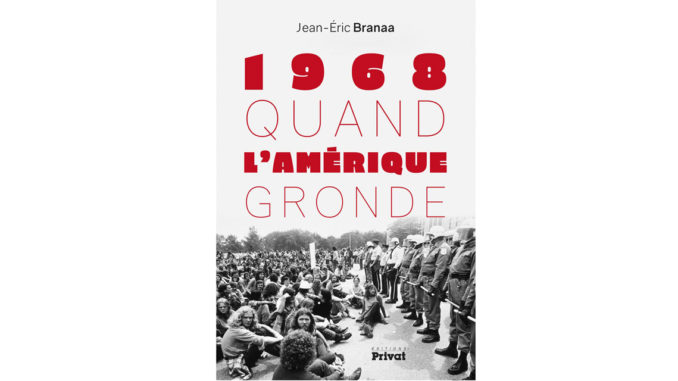
Jean-Éric Branaa (https://www.branaa.fr/) est chercheur associé à l’IRIS, spécialiste des États-Unis. Maître de conférences à l’université Paris II Panthéon-Assas, il répond à mes questions à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage « 1968, quand l’Amérique gronde », aux éditions Privat.
Pourquoi soutenez-vous le fait que Donald Trump souhaite revenir aux États Unis d’avant 1968 ?
Il nous faut nous rappeler de ce qu’ont été les États-Unis durant les années soixante : le pays n’avait pas encore atteint 200 millions d’habitants, mais 70 millions d’entre eux étaient encore quasiment des adolescents. C’est ce que l’on a appelé la génération du baby-boom, une conséquence du retour des soldats de la guerre, après une très longue absence. Les États-Unis pensaient alors s’appuyer sur cette jeunesse pour doper leur extraordinaire réussite de l’après-guerre.
Car c’était alors un pays non seulement très riche, mais qui connaissait aussi une croissance incroyable. Le pays produisait de plus en plus et s’était lancé à corps perdu dans la société de consommation de masse. On a vu de profonds changements dans la façon de vendre ou d’acheter et certains produits ont porté une symbolique forte. Ainsi, l’automobile, qui a tenu une place très particulière dans cette société. Elle est devenue un objet social, reflet de cette époque : les Américains la voulaient belle pour épater leurs amis et leurs voisins.
Cette décennie a souvent été décrite comme une société dirigée par l’acte de consommer. Les grandes surfaces se sont développées et multipliées partout, à la sortie des villes, qu’elles soient grandes ou petites, et en particulier le long des highways, ces routes qui traversent tous les États. La télévision a pris une place prépondérante dans la vie de chaque Américain : en 1968, il y avait déjà 56 millions de postes de télévision dans les foyers américains, qui étaient donc équipés à 95%. La télévision a véhiculé une vision très conservatrice de la société. Jusqu’aux années 1970, c’était un privilège d’apparaître à la télévision, plutôt réservé aux Américains caucasiens. Être blanc représentait une normalité qui n’était pas remise en question, quel que soit le type de programme (divertissement, sport, informations ou publicités).
Dans le poste, comme dans la société, il y avait un manque flagrant de diversité raciale ou de genre, absence que l’on retrouve avec la même vigueur au sein des classes sociales. La télévision s’adressait avant tout à ceux qui pouvaient s’offrir à la fois le poste et les produits qui étaient promotionnés par la publicité. Les classes sociales les plus modestes et le monde paysan ont en conséquence été délaissés et peu représentés. Les héros mis en avant étaient tous des médecins, des avocats, des journalistes et des chefs d’entreprise. Les autres professions, en particulier les métiers manuels, étaient dépeintes de manière négative ou peu reluisante, comme c’était déjà le cas avec les minorités raciales.
C’est dans ce monde qu’a grandi Donald Trump, lui qui était âgé de 22 ans en 1968. Il était donc un jeune adulte, tout comme la plupart de celles et ceux qui dirigent l’Amérique d’aujourd’hui. Leur imaginaire s’est formé autour de cette image très masculine – voire machiste – qui était projetée, avec une place très réduite pour les femmes, les minorités et les classes sociales les plus basses. C’est là qu’ils ont tous puisé leurs repères et leur construction d’adulte. Et c’est dans ce monde-là que le président américain veut effectivement revenir et ramener son pays. C’est le message subliminal, mais pourtant fort, de son slogan : « rendre à l’Amérique sa grandeur ».
Pourquoi percevez-vous la période 68-71 comme un bloc marquant la fin du siècle américain ?
Quand on évoque le siècle américain, on pense bien évidemment à Olivier Zunz et son ouvrage éponyme, au sein duquel il décrit l’attitude de ce pays qui réécrit sa propre histoire et en gomme les défauts. Depuis la fin du XIXe siècle, les élites libérales américaines ont tenté de construire une société parfaite, basée sur le capitalisme, qu’elles ont alors proposée aux autres peuples. Les Américains avaient la certitude que la classe ouvrière pouvait être détournée de la lutte des classes grâce à des salaires revus à la hausse. La société serait donc plus juste et plus prospère et cette classe ouvrière n’aspirerait qu’à un seul but, celui de devenir une classe moyenne.
La fin du XIXe siècle est un moment charnière dans l’histoire des États-Unis qui, avec la fin de la guerre hispano-américaine, jouent un plus grand rôle sur la scène internationale. Ils adoptent alors le protectionnisme pour protéger leur industrie et McKinley s’engage sur la voie de l’isolationnisme et de l’interventionnisme choisi, qui sera plus flagrant encore avec Theodore Roosevelt et son Corollaire à la doctrine de Monroe de 1904, proclamant le droit pour les États-Unis d’intervenir n’importe où en Amérique du Sud.
Le vrai tournant est bien entendu l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, qui devient la norme commune pour tous les États membres de la nouvelle institution créée trois ans plus tôt, l’Organisation des Nations unies (ONU). Mais on en est encore à un niveau politique et institutionnel, sans que les peuples ne se soient véritablement associés au processus. C’est pourtant ce qui arrive bien vite, lorsque les Américains réalisent que leur démocratie, ainsi basée sur le capitalisme, n’a pas gommé les plus criantes inégalités. Les Noirs en ont été exclus, mais aussi, les femmes, et toutes les minorités. Pire, nous dit Harrington, les Blancs eux-mêmes ont créé un sous-ensemble qu’ils ont refusé d’assumer : celui des pauvres.
Les années soixante deviennent alors un long combat de tous ces exclus pour la reconnaissance de leur situation et la fin des sixties marque la fin de ce siècle américain qui a montré ses limites et n’est plus supportable pour une grande partie de ce peuple.
La révolte étudiante est-elle aussi aux États-Unis l’image la plus marquante de l’année 68 ?
La révolte américaine est plus globale et plus profonde que les mouvements qui éclatent un peu partout dans le monde. La comparaison avec un autre pays trouve donc rapidement ses limites. Ainsi, en France, le mouvement étudiant devient l’élément central de la contestation : il est voyant, bruyant, mais également bref, principalement centré sur le mois de mai. Le mouvement étudiant américain n’est qu’une composante d’une révolution plus complexe : sur le socle d’une contestation à la guerre du Vietnam, la contestation est plus longue, mais aussi multiple, et ne cesse de se réinventer. On peut considérer que l’étincelle allumée par Samuel Harrington, qui déclenche la guerre à la pauvreté, est un élément moteur bien plus structurant. En réalité, il s’agit à chaque fois d’un même mouvement, commun à tout ce qui va survenir ensuite : le mouvement étudiant, les grèves ouvrières, la lutte pour les droits civiques, la seconde vague du féminisme, l’émergence d’un mouvement gay ou d’une conscience écologiste, la contre-culture, qui envahit tous les espaces et voit de l’art et de la vie partout et en tout.
Pour autant, le mouvement étudiant américain est fondamental, car il pose les bases politiques de tous ces bouleversements : il introduit et adapte le socialisme, ce qui semblait impossible dans un contexte de guerre froide intense. Par cela, il intensifie encore le choc de l’affrontement entre deux sociétés, qui se retrouvent dès lors dans un autre choc, celui des générations. La société « d’avant » ne comprend pas sa jeunesse ou – dit autrement – les parents ne semblent plus capables de comprendre leurs enfants. Tout va trop vite et trop loin aux yeux des plus anciens et des plus conformistes. Tout doit être réinventé aux yeux des plus jeunes : ceux-là introduisent donc le progressisme et, en donnant le pouvoir aux fleurs et à l’amour, entendent contester tous les modèles pour faire leurs propres expériences de la vie. En 1994, Bill Clinton déclarait : « si vous regardez derrière vous, vers les années 1960, et pensez qu’il y a plus de bon que de mauvais, vous êtes sans doute un démocrate. »
Les femmes ont brulé les soutiens-gorges, les gays ont gagné leurs quartiers à New York, les artistes ont libéré leur imagination, les noirs ont regagné leurs droits civiques, il y a tant à décrire dans cette Amérique en ébullition ! L’image qui est à retenir n’est pas tant celle de la révolte étudiante, de ses luttes pour l’inclusion, la liberté d’expression, ou pour réinventer la société : l’image forte est bien celle de la révolte de TOUTE sa jeunesse et de la cassure entre deux mondes, celui d’avant et celui d’après, que l’on retrouve dans toutes les strates de la société, jusqu’à la mode, le sport, la musique ou les objets du quotidien. C’était toute la jeunesse de l’Amérique qui grondait alors.

L’entretien est également disponible sur Mediapart Le Club.

