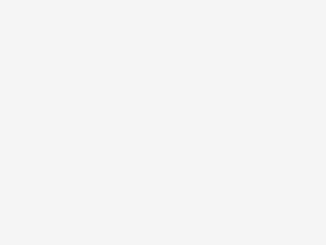François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS, spécialisé dans la communication, la cyberstratégie et l’intelligence économique, responsable de l’Observatoire Géostratégique de l’Information. Docteur en Sciences politiques, médiologue et blogueur influent (http://huyghe.fr), il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage : « Fake news : la grande peur », aux éditions VA Press.
« Fake news » : le terme est nouveau, mais le phénomène est-il ancien ?
Le phénomène commence peut-être avec Adam et Eve et est attesté depuis l’Antiquité. La rumeur, « plus vieux média du monde », a toujours concurrencé le discours officiel ou médiatique (car on nous cache tout) et, au cours de récents conflits (Yougoslavie, guerres du Golfe, Kosovo, Libye…), nous avons pu constater le succès d’accusations imaginaires concoctées par des services d’État ou des officines pour discréditer des adversaires (qui n’étaient pas pour autant innocents).
Ce qu’il y a de nouveau, c’est que les réseaux sociaux permettent à chacun de fabriquer de faux comptes, de retoucher des photos ou de les légender de manière mensongère, d’inventer des déclarations ou des évènements. On peut même créer de pseudo mouvements d’opinion par quelques algorithmes et multiplier les partisans imaginaires. Surtout, les réseaux sociaux ont créé de nouveaux circuits de circulation de la désinformation ou de la mésinformation : chacun peut reprendre, accréditer et amplifier la « nouvelle » fabriquée. Ainsi, il devient aisé de choisir en ligne des informations qui confortent ses fantasmes ou ses préjugés idéologiques.
Pour la petite histoire, l’anglicisme « fake news » (équivalent de notre « bobard ») a vraiment été popularisé en 2016 dans un contexte de panique des libéraux et des partisans d’une mondialisation heureuse face à l’incompréhensible montée populiste. Le néologisme traduit une sorte de perte de contrôle idéologique du cercle de la raison face à des opinions qui s’appuient sur d’autres valeurs, mais aussi sur une autre version de la réalité.
Pourquoi ne croyez-vous pas à l’influence russe dans l’élection de Donald Trump ?
Je ne nie pas que le Kremlin se soit doté de relais auprès de l’opinion internationale avec des médias multilingues comme Russia Today (mais en ne faisant là qu’imiter ce que pratiquaient les États-Unis pendant la guerre froide), ni qu’il y ait des « trolls » russes qui ont repris les rumeurs anti-Clinton en se faisant éventuellement passer pour des citoyens américains. Simplement ces influences ont joué à la marge et sur un public préalablement conquis : celui-ci était déjà convaincu du fait que les médias du système, « mainstream » et libéraux, répandaient des « fake news ». Attribuer un pouvoir de persuasion de nature à faire basculer le suffrage d’une Nation au seul fait que des millions de gens ont été exposés à un bobard au moins, c’est oublier qu’ils n’y ont pas forcément cru, que le faux a été rapidement repéré et dénoncé et qu’il a été forcément plus que compensé par des centaines d’heures de télévision et des milliers de pages influant en sens inverse.
La vraie question est plutôt de savoir pourquoi une telle proportion de la population ne croit plus les médias classiques, les élites, les experts… Attribuer le Brexit, l’élection de Trump ou le référendum catalan à la mauvaise influence de mensonges délibérés, à la crédulité naturelle des masses ou à l’anarchie des réseaux sociaux, ressort d’une causalité diabolique : le peuple vote mal à cause de mensonges subversifs ; s’il savait la vérité il nous soutiendrait. De plus, plusieurs études universitaires américaines ont récemment confirmé que le pouvoir des « fake news », des comptes « extrémistes » ou de la propagande extérieure, a été marginal, limité à une minorité de convaincus et concurrencé par bien d’autres sources d’influence. Il faut se méfier des explications magiques, surtout si elles flattent votre ego (nous sommes le camp des véridiques) et vous exonèrent de toute responsabilité.
Pourquoi les réseaux sociaux, vus il y a quelque temps comme les vecteurs de la libre expression, sont-ils aujourd’hui accusés d’être les fourriers du complotisme ?
En effet, au moment du printemps arabe, il était à la mode de dire que les réseaux sociaux, où chacun pouvait s’exprimer, qui se jouaient des frontières et que les pouvoirs autoritaires ne contrôlaient guère, étaient intrinsèquement démocratiques. Mais les médias sociaux ne donnent pas la parole qu’aux démocrates soutenus par l’Occident : les complotistes, les djihadistes, les anti-systèmes de toute obédience, les populistes, tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, doutent de la parole dominante (qu’il s’agisse de politique, de vérité scientifique…), y trouvent aussi un environnement favorable à leurs versions alternatives. D’où la mobilisation des gouvernements (loi Macron anti-“fake news”), des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), qui ne veulent pas être accusés de favoriser les délires antisociaux en ligne, et des médias classiques, qui justifient désormais leur rôle par la pratique du fact-checking.

-> Cet article est également disponible sur Mediapart Le Club.