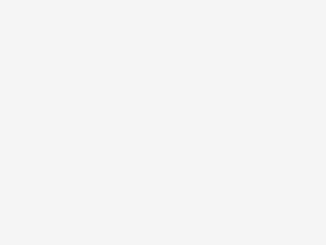Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po (Paris). Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage « Généraux, gangsters et jihadistes : histoire de la contre-révolution arabe », aux éditions La Découverte.
Comment définiriez-vous le système des « mamelouks modernes » que vous évoquez ?
J’établis un parallèle historique entre les cliques militaires qui règnent aujourd’hui sur de nombreux pays arabes et les Mamelouks qui ont gouverné l’Égypte et la Syrie de 1260 à 1516.
Ces esclaves affranchis par la carrière des armes s’étaient en effet imposés pour résister à la menace des Croisés, puis des Mongols. Mais ils avaient ensuite perpétué un pouvoir absolu, au nom d’un calife privé de toute autorité réelle. Je mets en lumière la même aliénation envers la société arabe qui frappe les juntes dictatoriales aujourd’hui ; comme les Mamelouks confinés dans leurs palais autrefois. J’insiste surtout sur la militarisation du politique qui en découle dans les deux cas : les Mamelouks d’hier et les autocrates de ce temps n’ont plus de rapport avec la population qu’en termes de prédation et de répression, avec désormais des plébiscites rituels de confirmation de la soumission au despote du moment. Peut-être encore plus significatif est le fait que les Mamelouks d’hier et d’aujourd’hui sont fondamentalement animés par des luttes de pouvoir inexpiables, là où les observateurs et les diplomates voyaient et voient rapports de forces géopolitiques et stratégies à long terme.
Je rappelle comment l’Égypte, perçue de 1956 à 1967 comme le phare du tiers-mondisme, était en effet soumise à un implacable bras de fer entre le président Nasser et son chef d’état-major Amer, qui conduisit d’abord à la calamiteuse expédition du Yémen en 1962, puis au désastre de la guerre des Six-Jours avec Israël en 1967. Même chose en Syrie où Hafez Al-Assad conquiert patiemment un pouvoir sans partage de 1963 à 1970, éliminant progressivement ses rivaux, sur fond pourtant de défaites cinglantes de l’armée syrienne face à Israël en 1967 et à la Jordanie en 1970.
Pourquoi, est-ce selon vous la répression méthodique de l’opposition légaliste qui a favorisé la croissance exponentielle de la menace jihadiste ?
C’est le cruel paradoxe de la contre-révolution arabe qui devrait invalider les discours faussement « réalistes » sur les dictatures arabes comme « moindre mal », voire comme « remparts » face au terrorisme. Or c’est tout le contraire qui se produit, avec un jihadisme en progression exponentielle du fait de la répression.
Deux types de raison expliquent ce phénomène : la collaboration directe entre les services de répression et les réseaux jihadistes, comme dans la Syrie de Bachar Al-Assad ou le Yémen d’Ali Abdallah Saleh (tué par ses alliés pro-iraniens en décembre 2017) ; la logique perverse d’une répression aveugle qui s’abat sur l’opposition non violente et fait basculer dans la lutte armée des mouvements ou des populations jusque-là pacifistes. Cette dernière dynamique est particulièrement à l’œuvre en Égypte, où l’ex-maréchal Sissi, au pouvoir depuis 2013, a réussi le tour de force d’enraciner Daech dans la population bédouine du Sinaï.
En Syrie, le régime Assad a attendu de longues années avant de combattre Daech, il lui a livré l’oasis de Palmyre pratiquement sans combat en 2015 et c’est fondamentalement la coalition menée par les États-Unis qui a pu libérer l’est et le nord de la Syrie des partisans de Baghdadi, et non la dictature en place à Damas, plus occupée à écraser ses opposants à Alep et ailleurs.
Quel parallèle dressez-vous entre l’Égypte, liée aux États-Unis, et la Syrie, liée à la Russie ?
Il est frappant de constater la continuité des structures des pouvoirs de ces Mamelouks modernes, indépendamment de leurs positionnements géopolitiques : l’Égypte est depuis 1952 dominée par un appareil militarisé, dont les services de renseignement, désignés en arabe sous le terme générique de « moukhabarates », ont une fonction essentielle de répression de l’opposition, ainsi que de quadrillage de la population ; et cette structure n’a pas été affectée par le basculement de Sadate, le successeur de Nasser, de l’alliance avec l’URSS vers la pax americana avec Israël. C’est ce que j’appelle le « jackpot israélien » où l’Égypte soutire autant des États-Unis de sa paix pourtant bien froide avec Israël que la Syrie soutire de l’URSS, puis de la Russie, de son « état de guerre » pourtant bien formel avec Israël.
L’essentiel est pour les régimes en place de garantir une rente géopolitique qu’ils présentent bientôt comme un dû auprès de leurs parrains étrangers. Les militaires égyptiens reçoivent ainsi depuis 1979 une rente annuelle de 1,3 milliard de dollars de la part des États-Unis, qui n’ont jamais pu reverser au moins une partie de cette aide à des projets de développement qui échapperaient aux militaires. De même, les Assad ont englouti depuis 1970 (Bachar succédant à Hafez en 2000) des montants colossaux d’aide soviétique, puis russe, sans qu’il ne soit jamais question pour eux d’en rembourser ne serait-ce qu’une partie. Cette rente liée positivement ou négativement à Israël a été étoffée aujourd’hui par la rente antiterroriste, à la fois géopolitique, financière et militaire, qui ne cesse de croître du fait de la progression exponentielle de la menace jihadiste évoquée auparavant.
La « stabilité » de tels régimes est donc la principale source d’instabilité et d’insécurité dans la région. Il serait peut-être temps d’en tirer toutes les conséquences.

Cet article est également disponible sur Mediapart Le Club.