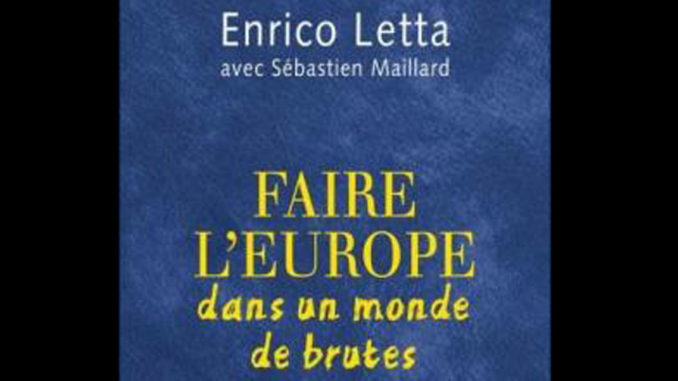
Enrico Letta fut chef du gouvernement italien dans les heures mouvementées de la crise de l’euro et de la crise des migrants. Il répond à mes questions à l’occasion de la parution de l’ouvrage, « Faire l’Europe dans un monde de brutes », aux éditions Fayard, fruit d’entretiens avec Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors.
Européen convaincu, vous regrettez néanmoins que l’Europe ait été façonnée principalement pour les élites.
Aujourd’hui, les citoyens européens vivant « sur leur propre peau » les grandes opportunités offertes par l’Europe représentent un faible pourcentage de la population totale. C’est la partie « cosmopolite » de nos sociétés. Je pense, par exemple, aux étudiants hautement spécialisés qui parlent différentes langues, aux managers qui voyagent souvent pour le travail, etc. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’avantages pour le reste de la population ; cependant, ceux-ci ne sont pas également évidents et tangibles.
Quand nous parlons d’Erasmus en tant que symbole par excellence de l’Europe, nous pouvons tomber dans un piège. Il est certainement vrai que le projet d’échange entre les étudiants universitaires a été et continue d’être un succès ; néanmoins, c’est précisément quelque chose qui ne vise qu’une partie de la société, c’est-à-dire les familles qui peuvent se permettre d’envoyer leurs enfants à l’université. Aujourd’hui, cette logique doit être élargie, afin que tout le monde puisse profiter de ce type de projets. L’Europe n’aura de futur que si elle parvient à entrer positivement dans la vie quotidienne de tous les secteurs de la société, afin de réduire au maximum le fossé réel, mais surtout perçu, entre les élites et le reste des citoyens.
La concentration géographique des institutions européennes à Bruxelles contribue également à creuser ce fossé, donnant l’impression que l’Europe n’est que froide, bureaucratique et distante, même physiquement, de la vie, des besoins et des préoccupations des citoyens. Le message n’est pas seulement trompeur, mais aussi contre-productif, car il aliène et décourage les populations. Dans le livre, j’ai intitulé un chapitre « Dé-bruxelliser », précisément pour attirer l’attention sur la nécessité de revoir la relation entre l’Europe et ses membres : européaniser certaines compétences ne signifie pas créer un « super-État » européen ; au contraire, cela signifie maximiser la valeur ajoutée pour le citoyen, selon le principe de subsidiarité.
Pourquoi, selon vous, est-ce la perception d’une domination allemande de l’Europe qui explique le ressentiment général des populations des autres pays ?
C’est une question complexe car de nombreux facteurs contribuent à donner une telle image de l’Allemagne. Tout d’abord, en période de difficulté, il y a toujours une tendance à identifier un ennemi externe à blâmer. Or, l’Allemagne, à certains égards, se prête bien à ce rôle.
Je pense toujours à une couverture de 2013 de l’Economist, dans laquelle l’Allemagne a été définie comme l’« Hégémon réticente ». La question est la suivante. D’un côté, le leadership de l’Allemagne en Europe est indiscutable ; il suffit de regarder les chiffres. D’un autre côté, parmi les classes dirigeantes allemandes, il semble y avoir encore une résistance trop répandue à exercer ce leadership jusqu’au bout ; et, par conséquent, en assumant aussi les fardeaux de la direction elle-même et en prenant en charge les intérêts propres et communs des autres Européens.
Au cours de la crise économique, les Allemands prétendaient imposer des réformes à tout le monde, mais sans un horizon idéal durable, c’est-à-dire un projet qui tient compte de l’évolution du contexte économique et social et qui interprète profondément l’esprit d’intégration entre les États membres. Celui-ci aurait pourtant dû être fondé sur la solidarité mutuelle et pas seulement sur l’orthodoxie comptable de la Bundesbank.
Mais je pense que quelque chose a changé au cours des dernières années. L’Allemagne est plus encline à assumer ses responsabilités de leadership. Le chaos mondial des trois, quatre dernières années – et je pense en particulier à la crise ukrainienne, la question des réfugiés et la menace du terrorisme – ainsi que les résultats des dernières élections, qui ont montré à tout le monde que même l’Allemagne n’est pas totalement immunisée contre l’avancée du populisme, semblent avoir inversé la tendance. En particulier, la crise des réfugiés a permis à Angela Merkel de jouer un rôle de véritable femme d’État, essentiel pour promouvoir une solution européenne partagée. Paradoxalement, cette nouvelle position, ou perçue comme telle à l’extérieur, a suscité une réaction presque contraire en Allemagne.
Dans les prochains mois, la contribution de l’Allemagne aux réformes en Europe sera cruciale. J’espère donc que l’incertitude politique qui a caractérisé les derniers mois au-delà du Rhin disparaîtra le plus rapidement possible.
Quelle distinction faites-vous entre « leadership » et « homme fort » ?
Partant d’un aspect sémantique, le leadership est un concept qui peut être décliné de plusieurs façons. Par exemple, il peut être vertical ou horizontal, diffus ou concentré, partagé ou individuel. Au contraire, quand on parle d’un homme fort, il n’y a pas beaucoup d’interprétations possibles : il n’y a qu’un seul individu. Mon concept du leadership est ainsi exactement inverse.
Je crois que dans le monde d’aujourd’hui, aux mille nuances et facettes, une seule personne, même bien préparée, n’est pas capable d’affronter seule la complexité des défis. Je suis un partisan convaincu du leadership partagé et diffus, qui exalte la diversité, qui cherche à impliquer et à responsabiliser le gens. Nous devons donc dissiper le mythe selon lequel il n’y a qu’un seul type de leadership, celui de l’homme fort. L’avenir exige un changement de paradigme, même dans le leadership.
Il ne s’agit cependant pas d’un modèle facile à encourager en temps de crise ou d’incertitude comme celui que nous traversons actuellement, où certains sont prêts à renoncer à une partie de leur liberté en échange d’une plus grande sécurité, compris à la fois d’un point de vue économique, mais aussi physique. Selon leur logique, les valeurs démocratiques sont incompatibles avec la sécurité. En réalité, cette incompatibilité n’existe pas : au contraire, nos valeurs sont un élément essentiel du bien-être et de la croissance. C’est la vraie bataille actuelle : une bataille culturelle. Gagner cette dernière permettrait de défendre nos valeurs, qui constituent la base de notre modèle de société. Au contraire, si nous ne trouvons pas une façon de rester unis, nous deviendrons de simples récepteurs de règles décidées par d’autres ; et ces autres sont des hommes forts qui sont à la tête de géants non européens…
Quelles sont les responsabilités du monde occidental dans les crises stratégiques actuelles ?
Les classes dirigeantes du monde occidental ont de nombreuses responsabilités et il est crucial qu’elles soient reconnues. L’alibi facile et banal du populisme, derrière lequel se cache une classe politique, ne permet plus de s’acquitter des lourdes responsabilités. Prenons deux exemples peut-être les plus pertinents à l’heure actuelle : la situation au Moyen-Orient et les inégalités.
Concernant le premier point, il est frappant de regarder les statistiques des demandeurs d’asile en Europe en 2015 : on y constate l’explosion de flux de réfugiés. Les trois premiers pays d’origine étaient, dans l’ordre, la Syrie, l’Afghanistan et l’Irak, qui coïncident avec les trois dernières grandes campagnes militaires de l’Ouest. À ces pays s’ajoute la situation difficile en Libye, aujourd’hui le théâtre de graves violations des droits de l’homme et de la jonction fondamentale dans le terrible trafic d’êtres humains de tout le continent africain. Il est évident que les grandes migrations sont un phénomène d’époque conduit par des processus démographiques ; cependant, les échecs occidentaux en matière de politique étrangère ont contribué à rendre la situation plus complexe, notamment par la formation de groupes terroristes.
Concernant le second domaine, celui des inégalités, on constate un échec des classes dirigeantes. En fait, la seule redistribution partielle des avantages de la mondialisation a laissé beaucoup de gens derrière – les soi-disant left behind – et a mis en difficulté la classe moyenne, qui est l’épine dorsale des démocraties. Tout cela a provoqué une polarisation interne des sociétés occidentales, créant, avec d’autres facteurs, un terrain extrêmement fertile pour le succès des partis antisystèmes. Mais il s’agit des effets de l’échec des classes dirigeantes, pas la cause ! Il est essentiel d’inverser cette relation de cause à effet.
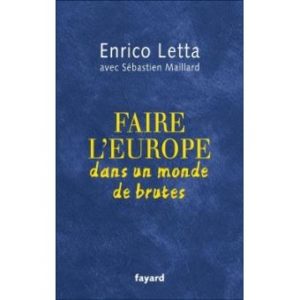
Cet article est également disponible sur Mediapart Le Club.


